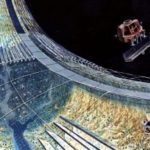Ce qui a commencé à se dissoudre et se perdre dès la fin des missions Apollo n’est pas seulement le rêve d’une colonisation de la Lune et de l’exploration humaine d’autres astres, mais l’émerveillement transmis par les premiers hommes ayant vu la Terre depuis son orbite proche ou, depuis la Lune, les premières descriptions de la poussière lunaire par ceux qui y posèrent les pieds. Or, c’est cet émerveillement que le film Gravity (Alfonso Cuarón, 2013) tente de recréer. Il est à ce titre une œuvre majeure sur la conquête de l’espace (auquel nous avons consacré un dossier). A travers la survie de l’homme dans l’espace, Gravity est un film qui nous rappelle les conditions de notre propre existence, ici, sur notre petite planète Terre (gravité, dioxygène, eau…). Comment s’étonner qu’il se conclue par un retour à l’océan primordial, au gestes fondateurs de l’émergence de l’eau et de la marche?
On a pu reprocher au film de ne raconter que cela : la survie d’un être humain dans l’espace, or la subsistance constitue l’enjeu premier de toutes les missions habitées, par-delà tout programme scientifique ou technologique. La présence de l’homme dans l’espace rappelle aux hommes restés sur Terre ce dont la vie ne peut se passer, d’où la force émotionnelle des respirations entendues dans le casque de l’astronaute incarnée par Sandra Bullock dans Gravity, tandis que les images de notre planète invitent à prendre conscience de son isolement et sa fragilité. La force du film d’Alfonso Cuarón réside dans sa juxtaposition de l’intense beauté du cosmos et l’intense désespoir de ceux qui savent qu’ils ne pourront y survivre sinon au prix d’un jeu où hasard et lois physiques se heurtent en permanence.

La psychologie des astronautes
La pertinence du film Gravity réside aussi dans sa description des processus psychologiques nécessaires pour être dans l’espace. Lorsque tout est question de survie, les émotions sont étroitement contenues dans les canaux des communications où le pragmatisme seul règne. C’est cette « psychologie des astronautes » qui est au centre de Gravity, objet de l’apprentissage de l’astronaute jouée par Sandra Bullock aux prises avec ses émotions présentes et passées (le souvenir de sa fille décédée). Dans un passage de Bivouac sur la Lune (1969), Norman Mailer décrit avec lyrisme et une grande justesse le conflit au cœur de chaque astronaute des missions Apollo vers la Lune, et par extension au cœur de notre civilisation :
D’un côté se trouver au centre même de la réalité technique (c’est-à-dire ce monde où toute question doit avoir sa réponse et sa procédure, faute de quoi la technique ne peut pas progresser) et pourtant habiter — ne serait-ce que dans leurs rêves — cet autre monde où doivent demeurer la mort, la métaphysique et les questions sans réponse de l’éternité, c’était révéler des natures si divisées qu’ils [les astronautes] auraient pu être les plus malheureux et les plus déséquilibrés des hommes, s’ils n’avaient pas enfermé dans ces énormes contradictions quelques-unes des plus profondes et des plus mouvantes du siècle lui-même.
(Norman Mailer, Bivouac sur la Lune, Paris, Éditions Robert Laffont, Collection « Pavillon poche », traduction de Jean Rosenthal, 2009, pp. 74-75.)
L’écrivain énonce dans Bivouac sur la Lune la contradiction d’un siècle qui « cherchait à dominer la nature comme jamais encore on ne l’avait fait » mais qui, grâce à la puissance même d’un complexe militaro-industriel saccageant l’environnement, était parvenu à confronter comme jamais l’homme à l’incroyable fragilité de son existence, déployant des moyens techniques faramineux afin d’envoyer dans l’espace des hommes, les maintenir en vie et les faire revenir sains et saufs.
« Le siècle créait comme jamais encore la mort, la dévastation et la pollution, ajoute Norman Mailer. Il s’attaquait pourtant à l’idée que c’était aux étoiles que l’homme devait emprunter sa conception de la vie. C’était le plus destructeur d’âmes, le plus apocalyptique des siècles. Aussi les astronautes à leur tour avaient-ils des personnalités d’une banalité sans égale et d’une dignité apocalyptique. » (Ibid., pp. 74-75.) Cette banalité et cette dignité sont parfaitement incarnées par l’astronaute joué sobrement par George Clooney, qui n’exprime aucune émotion violente lorsqu’il découvre les cadavres de ses camarades astronautes, conformément aux règles intégrées lors de ses longs entrainements, non parce qu’il ne possède plus d’émotions, mais parce que l’expression de ces dernières ne doivent pas nuire au bon déroulement du processus de survie qu’il élabore dès la prise de conscience de la catastrophe qui vient de se jouer.

Dedans et dehors
Se confrontant chaque jour à la machine, l’astronaute doit être à la hauteur de ses exigences mais aussi de ses défauts ; il doit se conformer à son mode de fonctionnement afin que le vaisseau et son équipage constituent comme un seul et unique corps. C’est à juste titre que la combinaison spatiale complète pour la marche sur la Lune (EMU) des astronautes est décrite par Norman Mailer comme un « vaisseau spatial en forme d’homme qui entourait leur peau » (Ibid., p. 525). De même, le module de commande d’Apollo et les combinaisons spatiales sont les extensions du corps des astronautes car sans ceux-ci, ils ne peuvent survivre dans l’espace inhabitable.
Dans l’espace, l’homme sans machine est comme écorché vif, ses entrailles mises à nu ; seul le sur-corps technologique semble permettre de réaliser le rêve de l’homme de s’affranchir des contraintes du corps. A la dépendance de l’homme envers ce sur-corps s’ajoute la fragilité de ce dernier, qui est mis en pièce par le nuage de débris qui transperce tout sur son passage, stations spatiales, capsules, astronautes. Le cadavre pétrifié par le froid au crâne transpercé par un débris rappelle la condition humaine lorsqu’elle est privée des machines qui maintiennent le corps humain en vie.

L’oscillation permanente entre le dedans et le dehors est à ce titre, on le comprend, essentielle dans Gravity. C’est en raison de l’importance des enjeux de cette oscillation, qui n’est autre que l’existence même de l’homme dans l’espace, que le long plan-séquence d’ouverture du film ne peut se réduire à une esbroufe tape-à-l’œil, tant il permet de rendre vraisemblable l’existence d’êtres humains dehors (grâce au sur-corps technologique), dans un point de l’espace qui leur est hostile, avant de rappeler que la vie ne peut perdurer que dedans le scaphandre ou le vaisseau lorsque les débris s’abattent. L’illusion de sécurité et de liberté dehors est balayée en une orbite, et l’astronaute incarnée par Sandra Bullock se retrouve projetée dans l’obscurité infinie.
Lorsque la caméra pénètre à l’intérieur du scaphandre de la jeune astronaute, l’oppression devient totale dehors (la nuit éternelle tourbillonnante) comme dedans (affolement de la respiration, des bips électroniques et des battements de cœur), faisant entendre non plus la voix réelle qui sort de son corps charnel, et non celle aseptisée et parasitée par la radio qu’émet son sur-corps technologique. La présence humaine est alors sensible, presque palpable.
Décrire la Terre depuis l’espace
Gravity m’a bouleversé par son contraste sidérant entre l’atroce mort immédiate du vide de l’espace et l’intense beauté du cosmos, de la Terre vue depuis l’espace. Le film invite, bien sûr, à contempler du dehors, ce dedans où nous évoluons, sous les couches de nuage de l’atmosphère terrestre. Même au seuil de sa perdition, et malgré son décontracté pragmatisme, le personnage incarné par George Clooney ne peut s’empêcher d’exprimer sa sidération face à la vision de la Terre, vaste corps (pour reprendre la terminologie des théories Gaïa) où l’être humain évolue naturellement et où le personnage joué par Sandra Bullock remarchera en rejouant la sortie de l’eau de ses ancêtres amphibiens. Même lorsque la situation des personnages de Gravity est désespérée, l’incroyable présence de l’homme dans l’espace, au dehors, est rappelée au spectateur par la chorégraphie des mouvements en apesanteur ou le ciel étoilé visible dans un hublot.

Il faut ici rappeler les quelques mots de ceux qui la contemplèrent lorsque les images de la Terre vue depuis l’espace n’étaient pas encore banales, de la sensibilité qui affleurent dans les description pourtant si sèches, si factuelles, du cosmonaute Youri Gagarine (1934-1968), premier homme de l’espace, et de l’astronaute Frank Borman (né en 1928) qui fut l’un des trois premiers hommes à frôler la Lune. Dans son passionnant ouvrage Le Rêve spatial inachevé, Patrick Baudry (second spationaute Français à rejoindre l’orbite terrestre) décrit le voyage incroyable de Youri Gagarine des steppes du Kazakhstan jusqu’au portes de l’espace interplanétaire. Gagarine décrit ainsi la Terre vue de l’espace, pour la première fois : « Une ligne d’horizon splendide. On voit bien la rondeur de la Terre. Elle est bordée d’un joli bleu. Une belle auréole bleue s’assombrit en s’éloignant de la Terre. » (p. 155.)
Ce qui m’intéresse dans ces paroles, c’est la nécessaire sensibilité qui y affleure car, comme Patrick Baudry l’écrit à propos de Youri Gagarine, ses paroles « émanent de la pensée d’un homme sensible, d’un humain confronté pour la première fois à cette vision lointaine de sa planète natale, grâce à ces yeux merveilleux capables d’identifier le moindre détail, d’intercepter la moindre variation de teinte. » (ibid., p. 155) Cette sensibilité est presque celle d’un peintre face aux variations de couleurs et de lumière de la nature qu’il représente sur sa toile, ou sensibilité du spectateur de celle-ci. En 1968, Frank Borman, le commandant de bord d’Apollo VIII orbitant autour de la Lune, décrira la Terre, quant à lui, en ces termes : « Et autour, il y a cette fine, très fine couche d’atmosphère. Il n’y a rien de plus. » (Ibid., p. 155)

En termes plastiques, nous pouvons donc écrire que la frontière entre Terre et espace vide est soit un cerne, un contour (« fine, très fine couche d’atmosphère » dit Borman), soit un dégradé (« Une belle auréole bleue s’assombrit » dit Gagarine). La différence de distance à la Terre explique ces deux descriptions différentes, l’« auréole bleue » décrite par Youri Gagarine paraissant bien ténue en effet depuis la Lune. Mais ce n’est pas tout, il s’agit d’une différence de vision du monde, comme le suggère Patrick Baudry qui écrit que cette « auréole de gloire bleutée engendrera des commentaires passionnés ou graves de la part de tous ceux qui succèderont à Youri sur les routes du ciel. » (Ibid., p. 155) Tout dépend en effet de la manière dont on conçoit la frontière entre la Terre (la vie) et le vide de l’espace (la mort). Soit comme une limite, séparation marquée de deux absolus : c’est semble-t-il le point de vue de Frank Borman. Soit comme un passage progressif de l’un à l’autre, dont la distinction doit être relativisée : c’est ce qui peut être déduit de la description de Gagarine.
C’est parce qu’il confronte, comme peu d’autres films, l’être humain au vide, que Gravity m’émeut : il rappelle que la vie tient à peu de chose, une alliance provisoirement fertile du hasard et des lois physiques, la vie étant un mince fil à l’image de la séquence où, par un concours de circonstance aussi improbable que notre propre existence, les astronautes incarnés par Sandra Bullock et George Clooney ne sont plus reliés à la station spatiale que par les câbles d’un parachute.

Épiphanies
Les visions, les pensées et le ressenti des astronautes doivent être extrapolés à partir de ces simples descriptions des faits observés : comment les mots pourraient-ils parvenir à exprimer ce qui dépasse, engloutit et sidère celui qui le contemple ? Il faut peut-être, pour comprendre cela et ressentir pleinement l’émotion de Gravity, avoir soi-même été confronté une telle vision épiphanique. Ce fut mon cas lorsque, à sept ans, je visitais l’observatoire d’Aniane près de Montpellier. J’étais déjà fasciné par l’astronomie, mais pas encore par la science-fiction. Regardant le soleil à travers le télescope, je vis sa couronne flamboyante tout autour du disque noir utilisé pour masquer la surface du soleil, brûlante pour l’œil du télescope et de l’homme. C’était tout. Je repartis avec cette image en tête, que je conserve jusqu’à aujourd’hui.
Combien d’enfants ont le privilège d’entrevoir un jour, de leur propre yeux, l’univers d’aussi près ? Trop peu. Non seulement la plupart de ces visions de l’univers ne sont pas vues des propre yeux de la quasi totalité de la population, mais elles parviennent, comme l’écrit Nathalie Labrousse, « à travers les médias de masse, comme la télévision ou les magazines de vulgarisation. Autrement dit, déjà, à travers des images extrêmement connotées, émotionnellement et moralement. » (Nathalie Labrousse, « Science-fiction et philosophie, La SF, un certain regard sur le monde », 1er festival international de SF de Nantes, octobre 2000)

Gravity propose au contraire des images de notre planète vue depuis l’espace réduites à leur plus simple expression, dénudées de leurs charges mythologiques (la Terre n’est pas Gaïa) ou idéologiques (pas de glorification de l’Amérique). La Terre est présente à presque chaque plan, aussi rassurante dans l’immensité sombre que menaçante lorsque tout ce qui orbite autour d’elle se désagrège progressivement dans son atmosphère.
Le cinéaste Alfonso Cuarón invoque les puissances technologiques du cinéma pour proposer aux spectateurs des simulacres d’épiphanies vécues par les astronautes, afin de rappeler à celui qui regarde le fait même de sa propre existence. Nous sommes en vie, sur une planète nommée Terre qui porte cette vie dans l’immensité glaciale et hostile du vide : tel est le simple message de Gravity, qui ne cessera d’être utile tant que nous oublierons ce simple fait. Il invite chacun d’entre nous à reprendre conscience de ce qui le constitue : son corps, son souffle, ses membres, l’eau, l’air, la Terre. Pour mieux, comme la jeune femme émergeant du lourd sur-corps technologique qui l’emporte au fond d’un lac sombre, se relever, marcher, être pleinement au monde. Vivre.
Version revue et corrigée d’articles publiés entre le 24 et le 26 novembre 2013 sur le site Éclats Futurs, puis sur Ouvre les Yeux.
Cet article sur le film Gravity fait partie d’un dossier consacré aux rapports entre réalité de la conquête de l’espace et imaginaire.