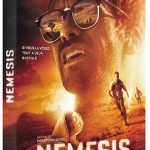Après avoir fait sensation en festivals l’an dernier, le premier long-métrage de Christophe Deroo, Sam Was Here, est sorti en DVD, Blu-Ray et VOD début avril, assorti d’un titre français peut-être moins mystérieux, Nemesis, afin de conquérir un plus large public. Nous avions soutenu ce thriller à l’atmosphère travaillée lors de sa présentation à L’Étrange Festival, aussi avons-nous profité de l’occasion — et du retour provisoire du réalisateur à Paris après un séjour au Japon — pour rencontrer son réalisateur afin d’évoquer avec lui la conception et la réception de ce premier long au budget modeste réalisé sans aides, mais aussi le parti pris de raconter une histoire cauchemardesque sans nécessairement en donner toutes les clés au public. La conversation se poursuivra au-delà de l’arrêt de l’enregistrement, autour de cinéastes aux univers singuliers tels que (bien sûr), David Lynch, mais aussi Dario Argento ou Tim Burton, et de la façon dont certains artistes parviennent à continuer de créer sans rentrer dans les conventions du système, ou éprouvent au rencontrent au contraire des difficultés de financement en raison des changements d’une industrie qui mise sur la carte de la sécurité…
Après avoir fait sensation en festivals l’an dernier, le premier long-métrage de Christophe Deroo, Sam Was Here, est sorti en DVD, Blu-Ray et VOD début avril, assorti d’un titre français peut-être moins mystérieux, Nemesis, afin de conquérir un plus large public. Nous avions soutenu ce thriller à l’atmosphère travaillée lors de sa présentation à L’Étrange Festival, aussi avons-nous profité de l’occasion — et du retour provisoire du réalisateur à Paris après un séjour au Japon — pour rencontrer son réalisateur afin d’évoquer avec lui la conception et la réception de ce premier long au budget modeste réalisé sans aides, mais aussi le parti pris de raconter une histoire cauchemardesque sans nécessairement en donner toutes les clés au public. La conversation se poursuivra au-delà de l’arrêt de l’enregistrement, autour de cinéastes aux univers singuliers tels que (bien sûr), David Lynch, mais aussi Dario Argento ou Tim Burton, et de la façon dont certains artistes parviennent à continuer de créer sans rentrer dans les conventions du système, ou éprouvent au rencontrent au contraire des difficultés de financement en raison des changements d’une industrie qui mise sur la carte de la sécurité…
Culturellement Vôtre : Dans l’entretien sur le Blu-Ray, vous dites que Rusty Joiner ne correspondait pas, au départ, à l’idée que vous vous faisiez du personnage. Quelle était donc l’image que vous aviez de Sam Cobritz ? Le choix de l’acteur vous a-t-il poussé à effectuer des modifications de scénario ?
Christophe Deroo : A la base, nous étions partis sur quelqu’un de plus « lambda », peut-être un peu plus fragile, moins musclé, moins grand. Et c’est vrai qu’une fois arrivés à Los Angeles et qu’on a commencé à caster, lorsque j’ai vu le portrait envoyé par l’agence qui nous a proposé Rusty, je me suis dit : « Mais c’est pas vrai ! Ils sont à côté de la plaque. Ce n’est pas du tout ce qu’on a demandé ». Mais, par acquis de conscience, j’ai tenu à le voir, et Rusty était extrêmement motivé par le projet et surtout, ce qui m’a sauté aux yeux d’emblée, c’est qu’il s’agissait clairement du meilleur comédien que nous ayons rencontré. Quand on regarde bien, il n’y a qu’un rôle pendant 1h15 et, même s’il ne correspondait pas à notre idée initiale, je ne pouvais pas fermer les yeux sur le fait qu’il était le meilleur.
Et bizarrement, avec le co-auteur, j’ai commencé à me dire que joué par Rusty, ce personnage ajoutait une espèce d’étrangeté. Plus j’y pensais, plus j’étais convaincu. Le plus important, c’est qu’au bout d’un moment, comme on finit par avoir un doute au sujet de la culpabilité du personnage, on peut voir que physiquement, il s’agit de quelqu’un qui peut se montrer dangereux. Cela apporte du coup de la crédibilité aux actes dont on l’accuse. Si on le voit attaquer quelqu’un, cela fonctionne. Je n’ai donc absolument pas regretté de l’avoir choisi, et je remercie d’ailleurs l’agence d’avoir vraiment poussé Rusty pour ce rôle. Comme quoi il ne faut pas rester trop figé sur ses idées de départ.
Culturellement Vôtre : Les thèmes de l’identité et de la folie ont très souvent été traités au cinéma, que ce soit avec ou sans twist final. Mais pour le coup, j’ai davantage eu l’impression que c’était les possibilités formelles qui étaient offertes par le sujet qui vous intéressaient. Aviez-vous une idée de départ précise par rapport à l’univers visuel que vous souhaitiez développer ?
Christophe Deroo : Au départ, c’était en effet assez précis dans ma tête, mais si le film est ce qu’il est, y compris au niveau de l’intrigue, c’est aussi lié à une affaire de budget. Avec les moyens dont on disposait, et la durée de tournage que nous pouvions nous permettre, qui était de 12 jours, je ne pouvais pas partir avec quelque chose d’extrêmement élaboré au niveau du casting. Gérer un comédien, c’est une chose, mais en gérer plusieurs demande un peu plus de temps de préparation. Donc le sujet s’est un petit peu adapté aux contraintes. Mais j’aime bien travailler dans cet esprit-là car j’estime que le cinéma est un média assez fort pour pouvoir parler de choses en les suggérant, et sans forcément les montrer directement. Et au final, cela m’allait très bien : ces contraintes m’ont motivé pour trouver des solutions. C’est vrai qu’instinctivement, quand on a une idée, on se dit « Je vais le rendre explicite » ou bien « il faut beaucoup de personnages », « étoffer ». Du coup, cela m’a permis d’aller à l’essentiel et d’imaginer un film tout en sachant que nous serions capables d’aller au bout en le maîtrisant. Il s’agissait de la donnée de départ, avec toute l’étrangeté et la bizarrerie que peut avoir l’histoire. Il s’agit d’un film qui a été fait hors-circuit, sans financement, sans aide, payé en partie de ma poche et celle du co-producteur. Il fallait donc aller vers quelque chose où l’on savait que l’on ne se casserait pas trop les dents d’un point de vue budgétaire.
Culturellement Vôtre : Il y a une vraie épure dans le film, et en même temps quelque chose d’assez organique… On pense aussi à Lost Highway pour certaines séquences, que ce soit par rapport aux décors (motel, désert) ou aux scènes d’enregistrement vidéo, qui peuvent faire écho aux cassettes anonymes que reçoivent le couple dans le film de Lynch. S’agissait-t-il d’une référence assumée ?
Christophe Deroo : Oui, tout à fait. David Lynch est l’un des cinéastes qui m’inspirent le plus. Au-delà la dimension étrange de son film, il s’agit d’un cinéaste qui me plaît par la dimension esthétique de son œuvre. J’ai fais des études d’arts plastiques avant de me tourner vers le cinéma, et je trouve que la compréhension de ses films ne passe pas uniquement par l’intellect. Il y a vraiment un lien émotif, qui n’est pas assez utilisé à mon goût dans le cinéma. C’est quelque chose que j’ai un peu tendance à regretter, quand des gens qui ont vu Sam Was Here viennent me dire « Je ne comprends pas ». C’est dommage, car ça veut dire que ces spectateurs s’arrêtent à l’aspect cérébral. Alors que, devant une œuvre d’art, j’ai des sensations, même si je n’arrive pas toujours à expliquer pourquoi. Et David Lynch a vraiment cette force-là : on ressent les choses. Lost Highway, d’un strict point de vue factuel, je ne le comprends pas. Par contre, c’est un film qui me tétanise d’un point de vue émotionnel. C’est quelque chose d’intéressant pour moi à partir du moment où dans mon histoire, il y a une idée de cauchemar, d’étrangeté, avec une impression de plonger dans un univers mental. A partir de là, je trouve que se limiter à l’explication intellectuelle n’est pas satisfaisant. Expliciter les choses évoquerait pour moi un état d’éveil, et non de cauchemar. C’était donc un choix assumé, et une référence que j’assume pleinement.

Culturellement Vôtre : Justement, craigniez-vous que les spectateurs se bloquent sur cet aspect cérébral et interprétatif et se disent, « Mince, la fin est vachement ambiguë quand même ! » et aient le sentiment d’être face à un film « de petit malin ».
Christophe Deroo : Je le savais à l’avance. Il y a en effet eu des retours négatifs sur le film, et je savais très bien que certaines personnes auraient ce ressenti. Mais j’assume pleinement ce parti pris de rester dans l’ambiguité, et je sentais qu’il fallait que j’aille dans cette direction. Ce n’est absolument pas une question de faire « mon petit malin », même si j’admets que des gens puissent le penser. Tout est parti des moyens que j’avais et de l’histoire que je souhaitais raconter, en essayant d’être le plus juste possible par rapport à mes intentions. Le ressenti que je voulais obtenir chez le spectateur à la toute fin, c’était qu’on se sente un peu paumé, comme lorsqu’on sort d’un cauchemar et qu’on ne sait pas trop quoi penser. Je ne vois pas pourquoi on devrait systématiquement avoir une résolution. J’apprécie également les films où le réalisateur vous prend par la main pour vous faire faire un tour, ça peut être agréable, et à la fin, on dit « Au revoir, merci ! ». Mais j’avais vraiment envie de travailler cette idée de cauchemar et de désorientation. Et pour l’aspect « petit malin »… Vu les conditions dans lesquelles on a fait le film, je ne vois pas pourquoi j’aurais essayé d’avoir une espèce de prétention.
Le film s’est monté avec une modestie tellement forte : on a dû trouver des solutions avec les moyens que nous avions pour aboutir au meilleur résultat possible. J’ai donc cherché à revenir à une épure absolue, sans effets tarabiscotés, ce qui pouvait être intéressant. Je comprends donc qu’on puisse avoir ce sentiment, mais je ne l’ai jamais ressenti de cette manière. Nous avons fait preuve d’une grande humilité, tout en sachant que ces partis pris pouvaient être clivants. Et puis vous savez, au niveau où j’en suis dans ma carrière, c’était un film « sans grands risques financiers », où je n’allais entraîner personne dans une banqueroute. Donc si à ce niveau-là, je ne peux pas me permettre d’expérimenter des choses, si je suis déjà formaté… A un moment, il faut se dire : « S’il y a bien un moment dans ma vie où je peux expérimenter des choses, c’est maintenant ». Pour le prochain, je risque d’avoir un peu plus d’argent, donc j’aurai d’autres formes de pression. Il est évident que ce film-là, si j’avais eu 50 millions, on m’aurait dit : « Cette fin, c’est juste pas possible ». Mais, dans ma situation, je sentais que c’était juste, sans savoir si j’avais tort ou raison, bien entendu, mais je le ressentais, donc je l’ai fait.
Culturellement Vôtre : Oui, et, dans un certain sens, quand il y a un twist final dans certains films, cela instaure une certaine distance, ce qui peut se révéler être une facilité. Alors que chez Lynch, par exemple, bien sûr on peut analyser et interpréter Lost Highway ou Mulholland Drive, mais cela ne nuit pas à la force du film, car on est vraiment à la place du « fou », de celui qui est à l’intérieur de ce rêve ou de ce cauchemar. Il n’y a pas ce recul, ce qui rend le tout plus fort et plus évocateur…
Christophe Deroo : Oui, et ce que j’aime aussi chez Lynch, c’est qu’il bouscule mes certitudes. A l’heure actuelle, il y a des films d’horreur où je trouve que le début est excellent, et à la fin, il faut qu’on nous explique pourquoi le fantôme fait ça. Et pour moi, c’est quelque chose de quasi-mathématique, à partir du moment où on m’explique et où je comprends, je n’ai plus peur. Je trouve le principe même du cauchemar, de l’angoisse, du mal-être (ce que Lynch fait très très bien), c’est justement quelque chose qui nous échappe. Ca paraît bête, mais les gens qui ont peur de prendre l’avion, 9 fois sur 10, sont rassurés lorsqu’on leur explique comment marche un avion. Pour moi c’est pareil : les choses qui me font peur, si d’un seul coup on commence à me les expliquer, cela me fait prendre une espèce de distance comme vous dites, et donc ça arrête de m’angoisser. Du coup, le fait de ne pas comprendre fait, qu’instinctivement, on va faire marcher notre intellect pour essayer de rationaliser les choses, ce qui va nous permettre de nous ouvrir un peu à l’univers de quelqu’un.
Les scientifiques fonctionnent aussi comme ça : on vit dans un univers qu’ils ne comprennent pas, donc ils conduisent des tas de recherches pour cette raison précise. Je regardais la conférence d’un mathématicien récemment, je n’ai pas compris grand chose, mais je n’en ai pas moins trouvé les concepts qu’il manipulait fascinants. Et à la fin, il a dit quelque chose qui m’a troublé, il a dit : « Si vous avez tout compris maintenant, c’est que je n’ai pas été assez clair ». Cela aurait voulu dire que quelqu’un qui aurait tout « compris », n’aurait pas capté les nuances de son propos. Et je ne vois pas pourquoi on devrait tout comprendre, surtout dans le domaine de l’art. Quand on va à un concert, on ne comprend pas nécessairement la musique, mais on la ressent. Pareil quand on est face à un tableau. Et pour moi, le cinéma, même s’il y a une ambition narrative, c’est comme de la poésie. Je suis un gros lecteur de poésie et quand je lis Isidor Ducasse (le comte de Lautréamont), on ne comprend pas forcément tout ce qu’il raconte d’un point de vue rationnel. Après, si cela frustre des gens, j’en suis désolé, mais à l’heure actuelle, c’est le meilleur moyen d’expression que j’ai pu trouver pour faire passer ce genre de choses, de sensations.
Culturellement Vôtre : La suggestion peut en effet être plus forte qu’une résolution explicite. Mais, d’un point de vue personnel, aviez-vous dans un coin de votre tête la « solution » de l’énigme, même si vous ne souhaitiez pas donner de résolution rationnelle au film ? Et si oui, avez-vous fait attention à ne pas trop orienter l’interprétation du spectateur ?
Christophe Deroo : J’ai en effet ma petite idée sur la question. Si les gens ont envie de revoir le film, il y a des détails qui sont là, non pour révéler la « clé » de l’énigme, mais plutôt pour donner une autre lecture. Au début, quand il est dans la station service, il voit une poupée qui lui donne envie d’appeler sa femme et sa fille, et c’est exactement la même qui se trouve à l’hôtel. Cela permet donc de faire un lien, de se demander s’il ne s’agirait pas de sa propre gamine. J’ai aussi fait en sorte que progressivement, on voit de plus en plus la peau et la chair du personnage principal. Cependant, à la toute fin, on voit la peau et la chair d’un personnage masculin de dos dont on ignore l’identité. Alors après, sans chercher à orienter la vision du spectateur ni dire « c’est ça », j’ai en effet mis tout un tas de petits détails, tout en faisant attention à ne pas trop en dire. Je trouve ça toujours très lourd et rassurant de dire « En fait il est fou, c’est dans sa tête ». Le principe même de la folie dans un univers mental, c’est qu’on est potentiellement tous concernés, on a tous notre part d’ombre. Par exemple, j’ai un vrai problème avec l’adjectif « inhumain ». Alors que non ! C’est humain d’être un salaud, une ordure, etc. Employer cet adjectif, c’est comme de dire « il est fou »…
Culturellement Vôtre : Ca permet de se rassurer sur soi…
Christophe Deroo : Oui. Alors que de dire : « Oui, en fait, il pourrait être comme moi et vriller comme moi », créer un malaise, c’est ce qui m’intéressait. Je pense également que c’est pour cette raison que cela peut créer un vrai rejet, car on sort de la zone de confort, où on a tendance à se dire : « Ca va, la morale est sauve ! ».

Culturellement Vôtre : Vous avez tourné sur douze jours, avec un budget très serré. Avez-vous dû modifier certaines scènes en raison d’aléas de tournage ou avez-vous pu filmer tout ce que vous aviez prévu ?
Christophe Deroo : Alors très franchement, non. Pour tourner en douze jours, nous avons beaucoup préparé en amont, notamment au niveau du découpage. Mais ensuite, une fois sur place, il y a eu beaucoup d’adaptation, car nous avons rencontré énormément de problèmes. Au début, cela me paraissait une bonne idée de tourner dans ce délai, mais cela pose un certain nombre de contraintes : les décors ont changé, le casting également, les actions… On s’imagine une scène d’une certaine manière, mais on doit parfois faire autrement. Par exemple, pour la scène avec le flic, on le sent pas trop, mais on a eu une tempête de sable qui nous a paralysés pendant très longtemps, ce qui fait que la scène est bien plus épurée que ce qui était prévu initialement. Mais ce n’est pas plus mal en un sens, car on s’est dit « Essayons de gérer ça même si ça part un peu dans tous les sens », on a fait en sorte de trouver des solutions. Et il y a eu aussi de belles surprises. Par exemple, la scène dans la casse, on aurait dû le faire dans une maison et, au moment des repérages, on a compris que tourner aux États-Unis chez des gens, c’est assez compliqué. Et, complètement par hasard, à un moment où on ne savait plus où aller, j’ai aperçu la casse au loin et on s’est dit que ce décor était chouette. On a demandé l’autorisation et on nous l’a accordée pour une bouchée de pain. Tout ça fait donc partie des petites adaptations que nous avons dû effectuer. Donc oui, c’était dur ! Marrant, mais dur.
Culturellement Vôtre : Et avez-vous coupé beaucoup de choses au montage ? Ou là encore, le film fini est fidèle à ce que vous aviez en tête ?
Christophe Deroo : En fait, pour moi, dès le départ le film devait faire 1h15. Deux heures, ça aurait été trop et n’aurait servi à rien. Pour ce que j’avais à raconter, je trouvais qu’il s’agissait d’une bonne durée. Du coup, on a beaucoup tourné utile, et en fin de compte, on a supprimé très peu de choses, peut-être de l’ordre de quelques plans. Mais aucune séquence n’a sauté, par exemple. D’un point de vue planning, on est pile rentrés dans ce que nous avions prévu de faire. Alors le film fini, par rapport à ce que j’avais en tête, il est très différent, mais correspond aussi aux contraintes que nous avions. De toute façon, je n’y crois pas trop de faire exactement ce qu’on a en tête. A partir du moment où l’idée rentre dans le réel, elle est déjà « abîmée », et c’était déjà pareil lorsque je faisais de la peinture. J’aime bien ce moment où on essaie de modeler la chose, justement. Ca nous échappe un peu, mais ça permet aussi d’être créatif. Psychologiquement, je n’ai pas souffert sur le film, je n’ai pas eu l’impression que j’étais en train de me trahir, que cela ne me ressemblait pas. Je trouve au contraire que l’expérience a été stimulante.
Culturellement Vôtre : C’est justement quelque chose dont parle régulièrement David Lynch, qui explique qu’il travaille aussi avec des « accidents », des choses qui n’étaient pas prévues. Comme dans Twin Peaks, où le personnage de Bob lui a été inspiré par un plan où l’on apercevait le reflet de l’accessoiriste, Frank Silva, dans un miroir, et il s’est écrié : « Bouge surtout pas, c’est génial ! ». S’il n’y avait pas eu cet incident sur le tournage, la série aurait probablement été différente, mais il a décidé de faire avec.
Christophe Deroo : Oui, et ça je pense que je le dois au fait que j’ai fait des études d’art. Par exemple, des fois, je faisais un trait, que je pensais avoir mal maîtrisé, mais en regardant le résultat, je me disais « c’est pas si mal » et je m’en servais. C’est le même phénomène et pour moi, faire un film, c’est pareil. Et il y a en effet des accidents heureux où l’on se dit « c’est bien et c’est même mieux que ce que j’avais prévu ».

Culturellement Vôtre : Comment s’est déroulé la conception de la musique avec Christine ?
Christophe Deroo : Ca s’est fait assez simplement car on est vite tombés assez rapidement d’accord sur ce qu’on avait envie de faire et nous avions un amour commun pour la musique de John Carpenter, qui est minimaliste, mais correspond encore une fois à une logique puisque s’il a fait de l’électro, c’est aussi parce-qu’un orchestre, ça coûte cher. Je trouve que ce qui était intéressant avec Christine, c’est que, comme ils viennent entièrement de la musique et n’avaient jamais réalisé de score pour un film, paradoxalement, ils ont été hyper à l’écoute de mon expérience. Du coup, ça s’est fait assez naturellement. J’avais peur que ce soit un peu compliqué, qu’on rentre dans des mimiques de CD — ce qu’ils ont un peu fait au départ — mais on s’est très vite mis d’accord. Et ce qui est amusant, avec l’électro, c’est qu’on peut aller triturer les sons, en trouver qui n’existent pas habituellement, des sons un peu étranges qu’on va davantage rapprocher de la sphère mentale. Donc ça s’est vraiment bien passé avec eux.
Culturellement Vôtre : Quels sont vos projets ?
Christophe Deroo : Je travaille actuellement sur mon deuxième long-métrage, un projet un peu étrange au Japon qui s’appellera Space Man et qui sera complètement différent du premier. On en est à l’étape de l’écriture et ce qui est pas mal, c’est que grâce à Sam Was Here, on a pu rendre crédible le fait que je puisse gérer un long-métrage, même avec très peu d’argent. Ce qui m’a moi-même surpris, d’ailleurs. Au départ, si j’ai fait ce film, c’était juste pour dire « Les gars, je suis là, je peux faire un film ! ». Et ce qui s’est passé avec les festivals et tout le reste, franchement, je ne m’y attendais pas du tout. En tout cas, ça fait que je suis devenu crédible sur certaines choses, ce qui n’était pas gagné au départ puisque, pour revenir sur le côté espace mental, les producteurs ont généralement peur de ça et essaient de vous orienter vers ce que les gens apprécieront facilement. Et bizarrement, j’ai eu beaucoup plus de critiques positives que négatives pour le film, ce qui me rassure. Je me dis que ça intéresse des gens et que je ne suis pas complètement à côté de la plaque à ce niveau-là, que le cordon émotionnel n’est pas tout à fait anesthésié.
Propos recueillis par Cécile Desbrun.
Nous remercions chaleureusement Christophe Deroo pour sa disponibilité et son amabilité. Nemesis (Sam Was Here) est disponible depuis le 6 avril 2017 chez Condor Entertainment. Découvrez notre test DVD ici et la critique complète du film ici.