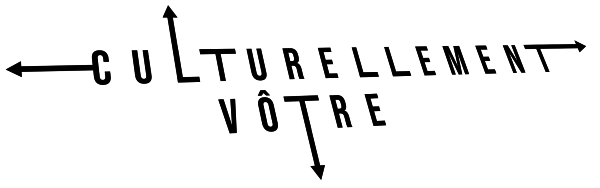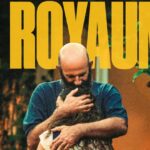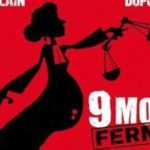Caractéristiques

- Titre : Les rêveurs
- Réalisateur(s) : Isabelle Carré
- Scénariste(s) : Isabelle Carré en collaboration avec Agnès de Sacy
- Avec : Isabelle Carré, Tessa Dumont Janod, Judith Chemla, Bernard Campan, Alex Lutz, Pablo Laury, Melissa Boros, Solan Machado-Graner, Nicole Garcia, Vincent Dedienne...
- Distributeur : Pan Distribution
- Genre : Comédie dramatique
- Pays : France
- Durée : 1h46
- Date de sortie : 12 novembre 2025
- Acheter ou réserver des places : Cliquez ici
- Note du critique : 8/10 par 1 critique
En 2018, Isabelle Carré publiait son premier roman, Les rêveurs, en grande partie autobiographique, aux éditions Grasset. Elle y évoquait son internement à l’hôpital pour enfants Necker à Paris suite à une tentative de suicide à l’âge de 14 ans. Aujourd’hui, elle adapte son livre pour son premier passage derrière la caméra.
L’occasion pour elle de mettre en images son vécu et l’impact de cette période de sa vie sur sa trajectoire de comédienne de manière personnelle et sensible, tout en portant un message d’espoir au jeunes, de plus en plus concernés par la dépression et les idées suicidaires alors que la psychiatrie en France manque toujours autant de moyens.
L’actrice-réalisatrice a choisi d’incarner Elizabeth adulte (un choix naturel) tandis que son alter ego à 14 ans est incarné par l’épatante Tessa Dumont Janod (dont il s’agit du premier rôle à l’écran), toujours juste entre sensibilité à fleur de peau, détresse contenue et caractère bien trempé.
Une comédie dramatique à hauteur d’enfant
Dès l’ouverture des Rêveurs, Isabelle Carré adopte une approche personnelle et se place immédiatement à hauteur d’enfant. Si le film est monté en flash-back et que les scènes dans le présent où nous suivons Elizabeth adulte sont moins nombreuses, la réalisatrice a fait en sorte d’établir en permanence des ponts entre ces deux temporalités de sorte à nous faire ressentir la manière dont les souvenirs de la comédienne remontent à la surface alors qu’elle commence à animer un atelier d’écriture créative à l’hôpital Necker auprès d’adolescents internés. Les scènes dans le présent sont relativement brèves, mais toujours justes et sensibles et les liens entre les deux périodes se font naturellement sans effets artificiels, ce qui renforce notre identification en tant que spectateurs.
Ce parti pris se fait sentir assez rapidement, à l’image de cette scène émotionnellement intense où l’on assiste à l’internement d’Elizabeth adolescente. Nous voyons la jeune fille entraînée de force par les infirmiers et séparée de ses parents. Puis, au détour d’un plan, un raccord nous permet de voir brièvement Elizabeth adulte dans cette situation à la place de celle qu’elle était adolescente avant de repasser de nouveau à Elizabeth jeune. Le procédé, simple et efficace, nous permet de comprendre que ces souvenirs et les émotions qui lui sont rattachées sont encore vifs pour l’adulte qu’elle est. Elle peut véritablement s’y replonger et avoir l’impression de les revivre en y repensant.
Tranches de vie en immersion dans un hôpital psychiatrique pour enfants
La majeure partie des Rêveurs se déroule en immersion au sein de l’hôpital pour enfants Necker à Paris 15ème, dans les années 80. Nous y suivons Elizabeth, qui rencontre et se lie d’amitié avec plusieurs enfants de l’unité de soins pédopsychiatriques, et plus particulièrement avec Isker et Renaud (incarnés par Melissa Boros, que l’on retrouve après Alpha de Julia Ducournau et Solan Machado-Graner). Nous assistons ainsi au quotidien des enfants au sein de l’hôpital, qu’il s’agisse de la prise en charge, les relations avec l’équipe soignante, les activités de groupe, les moments de complicité entre eux, mais aussi l’ennui prégnant et le sentiment d’enfermement.
Là encore, Isabelle Carré se concentre sur les émotions mais aussi, de manière plus large, sur la dimension sensorielle, afin que nous puissions partager et comprendre le ressenti d’Elizabeth, ses moments de doute, de peur et d’angoisse comme ses moments d’espoir.
La réalisatrice accorde une grande importance à l’ambiance sonore tout au long du métrage, avec un focus particulier sur celle-ci lors de différentes séquences où le son revêt une importance capitale et où le hors champ prend le pas, pour les personnages, sur ce que nous voyons à l’écran. Cela se produit une première fois peu de temps après la prise en charge d’Elizabeth, alors qu’elle dessine seule dans un espace commun et entend des bribes de discussions plus ou moins indistinctes en provenance d’une pièce adjacente fermée, puis lors de plusieurs séquences de nuit où elle se trouve dans une chambre avec ses camarades de séjour.
Ce procédé permet de nous mettre à la place de l’héroïne et de partager avec elle sa perception sensorielle et émotionnelle des choses, d’aider à comprendre ses angoisses dans ce lieu fermé, où le hors champ ne peut que prendre de plus en plus d’espace et où parvenir à s’échapper, ne serait-ce qu’en esprit, n’est pas toujours aisé.
La prise en charge des enfants et le manque de moyens en psychiatrie
Bien qu’elle ait clairement dit avoir lissé les choses et arrondi les angles par rapport à son expérience personnelle afin de pouvoir redonner espoir aux jeunes spectateurs et « ne pas leur enfoncer la tête sous l’eau » (interview complète à retrouver sur Télérama), le film montre également le comportement des psychiatres dans leur manière d’aborder les soins, et qui reflète en partie l’attitude du milieu de la psychiatrie dans les années 80, même si cette approche n’a pas nécessairement entièrement disparu des établissements de santé, malheureusement – ce qui est favorisé par un manque de moyens évident, sur lequel le film, militant, met également l’accent dans la partie se déroulant dans le présent.
Peu de temps après sa prise en charge, l’équipe soignante, dirigée par le chef de service incarné par Bernard Campan – avec lequel Isabelle Carré avait joué dans Se souvenir des belles choses et La dégustation – passe dans la chambre d’Elizabeth sans lui dire grand-chose. Elle l’interpelle alors qu’ils s’apprêtent à sortir en lui demandant comment il compte la soigner et l’aider à aller mieux. La réponse ne se fait pas attendre : « On passera tous les matins ajuster ton traitement », comme si les médicaments étaient le seul traitement possible avec le repos et l’isolement.
Les préjugés du corps soignant (les infirmiers plus particulièrement) sont également illustrés à travers une séquence au cours de laquelle Elizabeth raconte qu’elle avait voulu sauter de la fenêtre à 4 ans. Réaction immédiate de l’infirmière : « tu voulais déjà mourir ? » Ce qui fait (à juste titre) sortir Elizabeth de ses gonds : elle n’avait que 4 ans et pensait qu’elle s’envolerait simplement. L’attitude fermée de l’infirmière face à elle, inamovible et pétrie de certitudes, la met hors d’elle.
Enfin, le fait que les enfants sont, à cette époque, enfermés avec, au final, moins de droits que des détenus en milieu carcéral est également mis en avant puisque, comme le relève Elizabeth, les fenêtres sont fermées en permanence et qu’ils n’ont pas le droit d’aller s’aérer dans la cour de l’hôpital. Néanmoins, quand la jeune fille remet une pétition au chef de service afin d’obtenir le droit d’aller fumer dans la cour, elle obtient gain de cause. De même, juste avant sa sortie, l’entretien avec Elizabeth, ses parents et le chef de service se passe bien, celui-ci lui demandant comment elle envisage l’avenir. En ce sens, le film ne tombe jamais dans le manichéisme et montre aussi les aspects positifs, notamment dans l’évolution des pratiques en pédopsychiatrie pour la partie dans le présent.
Des moments de complicité entre ados : espoir et résilience
Mais, au-delà de la dépiction réaliste d’un hôpital psychiatrique pour enfants dans les années 80, Les Rêveurs est aussi un film porteur d’espoir, qui accorde une place prépondérante au long chemin vers la résilience des enfants hospitalisés. Un chemin amorcé grâce à la complicité qui naît entre les adolescents, leur permettant de recréer du lien, de mettre des mots sur leur vécu et leurs émotions, et de s’évader aussi de ce lieu morne et étouffant, de commencer à envisager l’après, lorsqu’ils sortiront.
Cette dimension est véritablement ce qui fait du film une œuvre aussi juste et touchante, poignante. Les dialogues, simples et bien écrits, sonnent juste. Surtout, les personnages des ados sont bien développés et caractérisés. Il s’agit de vrais ados, avec leurs rêves, espoirs, frustrations, obsessions et la naïveté propre à leur âge, ce qui apparaît clairement dans toutes les scènes où ils parlent de relations sentimentales (pour les filles) ou de sexe, de l’obsession des garçons de dire qu’ils ont déjà « galoche » une fille, etc. Le film est ainsi véritablement à hauteur d’enfant, et ce dès le premier flash back où nous découvrons Elizabeth enfant et son frère se vêtir de tenues Pierre Cardin trop grandes pour eux et s’amuser dans l’appartement parental au son de Dalida.
De manière générale, Les rêveurs (re)donne la parole aux enfants internés, met l’accent sur leur vécu et leurs situations familiales, allant de compliquées à dramatiques. Elizabeth est probablement dans une situation plus enviable que celle des autres enfants puisque sa famille, bien que compliquée, est aimante, qu’elle s’entend bien avec ses parents et son grand frère et vient d’un milieu aisé. Le film, à travers ces différents parcours, et ces histoires dont nous ne connaissons parfois que quelques bribes, nous permet aussi de comprendre et d’insister sur le fait que les problèmes psychiques chez les adolescents « ne tombent pas du ciel » et ont des causes le plus souvent environnementales (problèmes familiaux, harcèlement scolaire, déception amoureuse…) qui sont souvent ignorées ou sous-estimées par les adultes qui, empêtrés dans leurs propres problèmes, ont tendance à les minimiser ou à ne pas vouloir les voir.
La musique comme exutoire, catharsis et moyen d’évasion
L’importance de la musique, sa dimension cathartique et thérapeutique, est souvent mise en avant dans Les rêveurs. Elle permet aussi aux jeunes protagonistes de s’évader en esprit à plusieurs reprises, notamment lors d’une très jolie séquence où les trois amis sont dans une chambre, assis les uns à côté des autres, avec un casque sur les oreilles. La caméra passe alors de l’un à l’autre en gros plan et nous entendons ce que chacun écoute, et qui traduit leur état d’esprit et leur ressenti à ce moment-là. En ce qui concerne Elizabeth, il s’agit d’une chanson qui lui rappelle sa situation familiale et les non-dits au sein de son foyer, qui finit par le rendre pesant derrière le vernis des apparences d’une famille bourgeoise culturellement ouverte.
Il y a aussi cette séquence où les enfants dansent tous ensemble sur « Come on Eileen » des Dexys Midnight Runners (1982) et laissent libre cours à l’expression corporelle et une certaine forme de joie ou, au moins, de lâcher prise. Le choix de ce tube britannique est un probable clin d’œil au très beau film indépendant américain de 2012 Le monde de Charlie (The Perks of Being a Wallflower) de Stephen Chbosky avec Logan Lerman et Emma Watson, sur la dépression et la tentative de suicide d’un ado (abusé sexuellement par sa mère dans son enfance) et qui se retrouve lui aussi hospitalisé. Ce titre était la chanson-phare du film, également adapté d’un roman.
Le chemin vers la guérison : renaître à travers l’expression de soi, l’art et l’écriture
Le film raconte aussi la manière dont Elizabeth s’intéresse au métier d’actrice et trouvera dans le théâtre une catharsis lui permettant d’exprimer ses émotions et, plus que de simplement remonter la pente, de s’épanouir. Le film met ainsi en images le moment de déclic pour Elizabeth au cours de son séjour, qui coïncide avec celui vécu par Isabelle Carré : une scène du film Une femme à sa fenêtre avec Romy Schneider. Un passage mis en scène de manière simple et sensible. A plusieurs reprises au sein du métrage, la réalisatrice recourt également, par petites touches, à des effets de style poétiques simples et efficaces, comme les oiseaux qu’elle dessine dans son carnet qui s’envolent des pages et sortent par la fenêtre. Des passages qui apportent de l’émotion sans jamais trop en faire…
Ces séquences permettent aussi de comprendre d’autant mieux le parcours d’Elizabeth adulte, sa relation à l’art bien sûr, mais aussi comment elle parvient à nouer une relation de confiance avec les adolescents hospitalisés alors même que nous voyons peu de choses de cet atelier à l’écran.
Un film porteur d’espoir
Le film tout entier est porté par l’espoir et, de manière toute naturelle, c’est aussi sur ce sentiment que le film s’achève en mettant en parallèle la représentation de théâtre où la comédienne professionnelle joue devant les enfants de l’hôpital et le premier cours de théâtre du personnage à sa sortie de séjour dans les années 80. Un parti pris qui convoque beaucoup d’émotion dans les dernières minutes du métrage, assez bouleversantes. Avec, à la clé, un message précieux pour les jeunes : les émotions, même bouillonnantes et à fleur de peau, sont une richesse à cultiver et non quelque chose de dangereux dont il faudrait avoir honte, même s’il faut apprendre à les canaliser. Doublé d’un second pour les adultes : notre parcours, même en ce qui concerne les épisodes les plus douloureux d’une vie, peuvent aussi permettre d’aider les autres en retour, et ouvrir une porte pour des personnes en souffrance afin qu’elles puissent retrouver espoir et confiance en elles et en l’avenir malgré les obstacles rencontrés. Ce qui était le but avoué d’Isabelle Carré avec son roman, puis ce film destiné à un large public.
Vous l’aurez compris, Les Rêveurs nous a plus que convaincus, tant par sa mise en scène que la manière dont il développe son récit. La réalisation se révèle simple mais juste et sensible, avec un joli travail sur les cadres, l’ambiance sonore, et des partis pris esthétiques apportant poésie, douceur et une certaine lumière à un sujet douloureux, compliqué, encore tabou aujourd’hui. Au-delà d’Isabelle Carré, dont les qualités d’actrice ne sont plus à prouver, le casting d’enfants s’avère véritablement doué, avec un jeu toujours juste et naturel, qu’il s’agisse des enfants acteurs professionnels ou de ceux dont il s’agissait là du premier rôle à l’écran.
Le message porté par le film est quant à lui essentiel à une époque où la psychiatrie est toujours le parent pauvre de la médecine en France, avec des conséquences désastreuses (malgré les avancées importantes de la recherche et des pratiques) sur la formation du personnel soignant, les recrutements et la prise en charge des patients de tous âges. Une situation dramatique pour les enfants en souffrance, un sur deux ne pouvant recevoir de soins adaptés… voire de soins tout court comme le rappelle un carton à la fin du film.