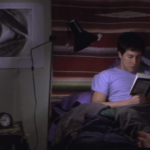C’est un plan banal du film Star Wars, Episode II, L’attaque des clones (George Lucas, 2002) : Anakin Skywalker caresse le dos de Padmé, puis se penche pour l’embrasser. Et pourtant, le commentaire audio de George Lucas révèle que l’acteur Haydn Christensen n’a pas posé sa main sur les jolies épaules de Natalie Portman, mais que celle-ci a été ajoutée en post-production lorsque le cinéaste s’est rendu compte que son personnage ne pouvait pas d’emblée embrasser la jeune femme. Anodine, cette petite scène ? Pas plus que celle où les deux tourtereaux discutent dans l’herbe, qui a demandé une quantité astronomique d’heures de travail aux employés du service rotoscopie chargés d’effacer chacun des innombrables insectes pullulant dans l’herbe lors de la prise.
Aujourd’hui, nous sommes guère surpris de telles pratiques (le remplacement de visage et le maquillage numérique abondent), même si elles peuvent continuer à étonner pour des plans aussi anodins. Depuis le début des années 2000, le cinéma s’est transformé par les outils du numérique. Premier blockbuster entièrement tourné digitalement, Star Wars, Episode II, L’attaque des clones, est l’aboutissement d’un long processus ayant permis au cinéma d’acquérir une forme nouvelle de « picturalité », au sens où le cinéaste peut comme un peintre choisir d’ajouter, de déplacer ou supprimer tel ou tel élément en cours de postproduction, pouvant à loisir choisir leurs parfaits nuages sans avoir à attendre des jours et des jours comme Eisenstein ou David Lean… Le cinéma devenant hybride, il contrevient de plus en plus à la règle énoncée par André Bazin dans son article célèbre « Montage interdit » : « Quand l’essentiel d’un événement est dépendant d’une présence simultanée de deux ou plusieurs facteurs de l’action, le montage est interdit. » (in Qu’est-ce que le cinéma ?, Éditions du Cerf, 2002, p. 59.)
Les montages interdits du cinéma numérique
Sans raccord, sans montage le temps d’un ou de quelques plans, le spectateur est invité à accepter la vérité de l’image grâce la présence simultanée, dans un même cadre, des deux éléments qui composent un événement. Il convient toutefois de rappeler que depuis les premiers temps du cinéma, cette co-présence a pu à de nombreuses reprises être un simulacre, composé d’éléments de sources diverses (peintures sur verre, matte-paintings, retro-projections, maquettes…).

Incontestablement, les outils du numériques démultiplient les possibilités de perversion du gage d’authenticité que constitue le « non-montage ». Ils offrent aux cinéastes la possibilité de réaliser deux fantasmes annoncés par la séquence d’exploration de la photographie de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) : la rotation de la caméra autour d’un objet dont le mouvement est figé ; et la pénétration de tous les espaces par la caméra.
Le premier fantasme se réalisera sous la forme de l’effet bullet-time popularisé par Matrix (Lana et Andy Wachowski, 1999), auquel Michel Gondry et Emmanuel Carlier avaient déjà recours en 1995. C’est une photographie transformée en espace pouvant être parcourue par une caméra virtuelle qui est produite par cet effet, réalisé grâce à une batterie d’appareils photos disposées autour du sujet, et dont les images seront reliées grâce au morphing. Un instant peut dès lors être parcouru comme un espace (reconstitué en images de synthèse) au temps dilaté.

Le second fantasme est presque aussi vieux que le cinéma, comme en témoigne la séquence de Citizen Kane (Orson Welles, 1941) dans laquelle la caméra semble pénétrer par une vitre fermée du toit d’un bar pour rejoindre l’ex-épouse de Charles Foster Kane en un mouvement descendant. Ce n’est plus le temps qui est violé, mais la séparation entre le dedans et le dehors, ou le modèle et son reflet comme en témoigne l’impressionnant plan de Contact (Robert Zemeckis, 1997) dans lequel un travelling arrière dans un couloir est présenté in fine – contre toute logique – comme un plan de l’intérieur d’un miroir.

Par la liaison sans coupure d’espaces-temps différents ou la pénétration de la caméra dans tous les espaces, sans obstacles (à travers les trous de l’écouteur du téléphone de Matrix, par exemple), le cinéma numérique efface les ruptures, sinon la présence de la caméra, afin de donner l’illusion d’un continuum qui ne serait autre que le monde. Mais ce « non-montage » ne révèle qu’une chose : l’impossibilité que ce monde soit autre chose que cinématographique. La négation de la présence de la caméra, grâce au numérique, contamine quant à elle les scènes réellement captées en leur ôtant l’effet de réel qui pourtant les définit. Croire et ne pas croire, telle est la poétique des cavernes numériques.

Le doute ne naît pas tant de la confusion du réel et du virtuel que de la confusion des images, l’esthétisation de la réalité ayant tout mis sur un même plan. Soudain, lorsque les chars explosent au début d’Avalon (Mamoru Oshii, 2004), les flammes se figent, deviennent grisâtres et verdâtres, tandis qu’un travelling dévoile « en coupe » les différentes couches d’images 2D de flammes, traversées par des lignes horizontales comme une VHS mise sur pause (les obus et morceaux de terres figées en l’air lors de l’explosion sont en revanche en 3D). Comme dans Matrix, un effet bullet time est produit par la fixation d’un mouvement extrêmement rapide contourné par un travelling demi-circulaire. Mais ici, le mouvement de caméra n’a pas pour but de révéler les trois dimensions de l’objet, mais le fait qu’il s’agit d’une image 2D qui se défait lorsque l’on ne respecte pas le point de vue unique indispensable au trompe-l’œil. Bien sûr, c’est la pseudo-tridimensionnalité de l’écran qui est dénoncée par un tel procédé, dont l’effet se fonde justement sur la croyance du spectateur en celle-ci, tout comme le graveur M.C. Escher démontait les pouvoirs et révélait les failles de la perspective.
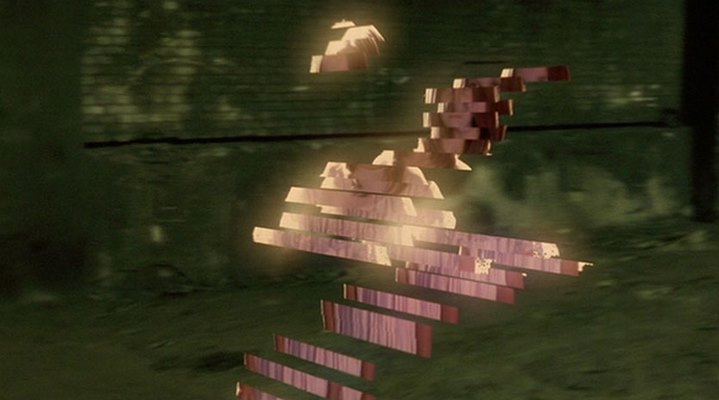
Le réel devenu base de données
Les plus efficaces des peintures sur verre ou matte-paintings réalisées pour des films sont celles dont la technique est plutôt impressionniste, où la touche est paradoxalement visible, telles celles d’Albert Withlock pour Tremblement de terre (Mark Robson, 1974). À l’inverse, les matte-paintings numériques ne possèdent pas de touche (sauf volonté d’obtenir un résultat semblant peint), puisqu’il sont composés d’images de synthèse et d’éléments photographiques retouchés avec des outils numériques. Leur « picturalité » s’est déplacée dans la mesure où l’image photographique ou cinématographique est devenue une seconde nature, une matière que le cinéaste lui-même saisit et déforme, fait resurgir dans le réel qu’il filme.

L’image photographique et l’image cinématographique sont des bases de données sur le monde dans lesquelles puisent les dessinateurs, infographistes, programmateurs et animateurs 2D et 3D. Le terme d’« images de synthèse » doit être lu comme l’action de « choisir, parmi les propriétés qu’il peut observer dans les objets de la nature, celles qui traduisent le mieux l’image qu’il veut en donner. » Ce sont les mots employés par Jan Blanc dans Peindre et penser la peinture au XVIIe siècle (Éditions Peter Lang, 2008, p. 81). L’auteur de cet essai synthétise les écrits du peintre Hollandais Samuel van Hoogstraten, qui ne sont pas sans évoquer les procédés utilisés dans les séquences d’effets visuels afin d’ancrer dans le réel de pures créations de « synthèse ».
Les sources d’images se mêlent dans Ghost in the Shell 2, Innocence (Mamoru Oshii, 2006) qui juxtapose la stylisation du dessin des personnages au photo-réalisme des décors en images de synthèse le plus troublant, étendant considérablement l’effet dit de « masque » typique des mangas, brillamment analysé par Scott McCloud dans L’Art invisible (1993). Xavier Kawa-Topor et Ilan Nguyên écrivent avec justesse que le « passage permanent de l’image réelle à l’animation prend de toute évidence un sens particulier au regard du thème majeur d’Oshii : le dépassement de la condition humaine comme horizon du développement technologique et le glissement progressif de l’existence vers la virtualité. » (in De Tron à Matrix : réflexions sur un cinéma d’un genre nouveau [dir. Ludovic Graillat], Cinémathèque de Toulouse, CRDP Midi-Pyrénées, PNR Cinéma de Toulouse, 2006, pp. 135-136)

Ainsi l’animation « porte ontologiquement en elle l’accomplissement de ce projet » de redéfinition du réel et de l’être à l’ère du virtuel que porte l’œuvre de Mamoru Oshii. Le cinéma devenu peinture, grâce aux ressources du numérique, de la rotoscopie et du dessin animé, offre ainsi aux cinéastes les moyens de créer une nouvelle « inquiétante étrangeté ».
Lens flares et tremblements virtuels
L’effet de réel doit permettre au spectateur de croire à ce qu’il voit. Or, paradoxalement, il doit croire que la caméra était réellement là pour filmer l’événement. Depuis les superbes maquettes de Rencontres du troisième type (Steven Spielberg, 1977) et de Blade Runner (Ridley Scott, 1982) orchestrées par Douglas Trumbull, les spécialistes des effets visuels ont pris soin d’insérer des halos de diffraction de la lumière au sein de l’objectif (lens flares), ces « accidents » redoublant l’impression de grandeur de ces maquettes (comme de gigantesques sources de lumière nous éblouissant). Originellement, ces effets de prisme, tout comme les tremblements de la caméra ou salissures de l’objectif, devaient être évités par les opérateurs dans les films en « images réelles » (ou live action) car ils trahissaient la présence de la caméra. Or, ils sont depuis ajoutés intentionnellement aux images créées par ordinateur afin de simuler la présence d’une caméra.

La présence d’une caméra virtuelle est affirmée dans des séquences qui sont d’évidence en images de synthèse, donc non captées. Cela se traduit par une simulation de caméra portée, des éclaboussures sur l’objectif, des tremblements et des secousses. Pour une vision de tous ces effets en une seule et même séquence, nous conseillons de visionner avec attention la séquence de bataille de la fin de Star Wars, Episode II, L’attaque des clones. Laurent Jullier écrit à propos des zooms rapides et maladroits de cette séquence, dits « sales » ou « lo-fi » (low-fidelity ou basse fidélité) que « ces défauts de cadrage connotent de nos jours la prise de risque ou bien l’amateurisme des cameramen, donc la vérité (on nous passe ces images parce que ce sont les seules qui nous soient parvenues à ce sujet). » (Laurent Jullier, Star Wars, anatomie d’une saga, Éditions Armand Colin, 2005, p. 59)

La création de simulacres de caméras pour de nombreuses séquences en images de synthèse participent de la création de « signes du réel » qui ne sont autres que des signes de la matérialité des techniques de représentation. En effet selon la conception de Marshall McLuhan que résume Julie Martineau, « lorsqu’on lit un texte, ce n’est pas son message qui est vraiment important, mais le fait précisément qu’il soit imprimé : on assiste à la « substitution au réel des signes du réel », par un effet de fascination technologique. » (Julie Martineau, « De la caverne à la machine : Platon, Lem, Dick et le ruban des simulacres », Arob@se, Volume 3, n°2.)
Un nouveau pittoresque
Jan Blanc écrit à propos du tableau de paysage pittoresque au XVIIe siècle qu’il s’agit, « pour imiter la nature « pittoresque », de l’ »inventer » en sélectionnant les effets singuliers (voire les défauts, s’ils peuvent être éloquents ou significatifs) et les propriétés qui permettent de créer l’illusion de la nature réelle » (op. cit., p. 81). En somme, les effets de réel des séquences constituées d’effets visuels peuvent être considérés comme une forme nouvelle du « pittoresque », celui d’un cinéma devenu peinture. Dans son essai Cinéma et peinture, Luc Vancheri cite avec justesse une réplique prononcée par le Van Gogh des Rêves d’Akira Kurosawa (1989) :
« Quand je suis devant ce morceau de nature, le tableau m’apparaît déjà fait. » Cette disposition du regard, du sujet devant le monde, fait le peintre, bien avant qu’il ne se saisisse d’un pinceau. À tel point que ce peintre-là, sans pinceaux ni couleurs, est tout aussi bien écrivain que cinéaste, artiste en somme.
(Luc Vancheri, Cinéma et peinture, Paris, Éditions Armand Colin, 2007, p. 121.)
Et comme tous les peintres, les artisans du cinéma numérique peuvent étaler un goût aussi variable que les références qu’ils invoquent et que leur capacité à se les réapproprier, et se complaire dans des artifices qui seront vu demain comme des clichés datés (est-ce utile de citer J.J. Abrams ?). Comme tout jeune réalisateur, je connais les envies de belles images qu’on peut éprouver. Or, on pourra dessiner le mieux possible une idée de plan dans le plus beau story-board du monde (qui n’a pas pourtant vocation à être une œuvre d’art), on pourra la filmer avec application et passion, ou la réaliser grâce à toutes les ressources offertes par la technologie, cette belle image devra peut-être être balancée dans la poubelle du monteur. Pourquoi ? Parce qu’un film est un tout, et qu’une belle image ne peut exister indépendamment du reste du film. Dans Le Film, sa forme, son sens (1932), Eisenstein met en garde contre l’accent mis sur la beauté des plans qui tend à briser le récit du film en mettant en danger la continuité du montage, le plan accrochant le regard au détriment de l’ensemble au sein duquel il s’insère : « Il arrive que l’on remarque dans des films quelques beaux plans, mais dans ce cas la valeur de ces plans et leur qualité picturale propre se contredisent l’une l’autre. S’ils ne sont accordés à la conception profonde du montage et de la composition, ces plans ne sont que des joujoux d’esthète et une fin en soi. » (« De la pureté cinématographique», in Le Film: sa forme, son sens, Éditions Christian Bourgeois, 1976, p. 100)

« D’ailleurs, plus les plans isolés sont beaux, plus le film qui les contient ressemblera à une juxtaposition incohérente de belles phrases » poursuit Eisenstein. En effet, lorsque le regard s’accroche à un plan particulier, il perd de vue la totalité. Ce n’est plus l’architecture de l’œuvre qui est visible mais son détail, qui détourne le regard et menace la compréhension du récit représenté, l’esprit étant concurrencé par l’œil irrémédiablement attiré. Blade Runner (auquel je consacre un essai, en cours d’écriture) a conduit nombre de critiques à considérer Ridley Scott comme un tel esthète dont le film serait le jouet, et qui se soucierait plus de la beauté de la composition des plans, de la lumière et la perfection du design que du récit, tendance associée à sa formation de réalisateur de publicités. Mais je crois au contraire que la multiplicité des plans qui accrochent l’œil font de Blade Runner un monde, avec son univers de pluie permanente et de néons, à la différence d’un film récent tel que Sucker Punch (2011), d’un autre réalisateur qualifié d’esthète par nombre de critiques, Zach Snyder qui se contente d’aligner des désirs d’images. Qu’ils soient inspirés par les jeux vidéos, les mangas ou l’esthétique grandiloquente des peintures d’Histoire du XIXe siècle, ces désirs ne suffisent pas à donner naissance à des mondes, et encore moins à un récit.
« Notre environnement ne s’est pas virtualisé, écrit Hervé Aubron ; c’est plutôt que les signes se sont sédimentés en une croûte, par-dessus notre terre natale. » (Mulholland Drive de David Lynch, Dirt Walk With Me, Éditions Yellow Now, 2006, pp. 47-49) La « croûte » du cinéma numérique est composée de la culture présente et passée (à l’instar de la peinture orientaliste invoquée par Gladiator), elle témoigne de son appropriation, et à travers elle de la persistance des rêves de représentation des hommes, ce besoin d’illusion qui est « tout mental, inesthétique en lui-même, dont on ne saurait trouver l’origine que dans la mentalité magique, mais besoin efficace dont l’attraction a profondément désorganisé l’équilibre des arts plastiques » selon André Bazin (op. cit, p. 11). Demain, les symptômes du cinéma numérique dont Sucker Punch regorgent seront perçus, peut-être, comme les marques d’un « pittoresque » que le spectateur du futur appréciera avec le détachement d’un spectateur de notre temps face à un paysage bucolique imaginaire du XVIIIe siècle…

Article publié initialement sur le site Ouvre les Yeux, le 28 janvier 2016.