
C’est l’un des plus beaux livres consacrés à la musique à être publié en cette fin d’année : Motown d’Adam White est sorti le 12 octobre dernier aux éditions Textuel. Un grand et bel ouvrage, volumineux, qui se regarde autant qu’il se lit, de préférence en écoutant les nombreux titres et albums cités par l’auteur dans le livre. L’ancien journaliste anglais, ex-vice-président de la communication d’Universal International, se penche sur l’histoire de la plus importante maison de disques noire des années 60-70, et embarque le lecteur dans les coulisses, auprès des artistes, auteurs et musiciens, mais également des dirigeants et commerciaux ayant permis au label, fondé en 1959, de devenir le premier faiseur de tubes soul de son temps, avec des artistes d’une importance historique capitale tels que Stevie Wonder, Marvin Gaye ou les Jackson 5. Adam White, fin connaisseur de la Motown, dont il a eu l’occasion de rencontrer de nombreux artistes et collaborateurs, a compilé une somme phénoménale d’informations sur le sujet tout au long de sa carrière, et a bénéficié du soutien de Barney Ales, qui fut le bras droit du fondateur Berry Gordy durant de nombreuses années.
Un livre rare, dont Adam White est venu assurer la promotion à Paris la semaine dernière. C’est à l’hôtel Arvor, non loin de l’Élysée Montmartre où se tenait le MaMa Festival, où il devait participer à une table ronde, que nous le rencontrons au lendemain de la sortie de Motown en librairie. L’échange sera long et détendu, l’auteur n’ayant apparemment pas d’autres interviews avant le déjeuner, et ce passionné de musique, qui connaît son sujet sur le bout des doigts, se révèlera particulièrement affable, nous permettant de prolonger le plaisir de la lecture. Rencontre avec l’un des experts les plus pointus de la Motown.

Culturellement Vôtre : Bonjour, vous avez été rédacteur en chef du magazine Billboard et vice-président de la communication chez Universal International pendant 10 ans. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre parcours ?
Adam White : Oui, tout à fait. Vous savez, lorsque j’ai entendu la musique de Motown pour la première fois, au début des années 60, j’étais un jeune homme. Puis j’ai été engagé dans un magasin de disques, c’était mon tout premier emploi, et j’ai persuadé le propriétaire de vendre des disques de la Motown. Nous avons ouvert un service postal pour envoyer des disques aux fans à travers tout le Royaume-Uni avant que les disques Motown ne deviennent vraiment populaires. C’est ce qui m’a en quelque sorte fait rentrer dans le milieu. Je rédigeais également des newsletters sur les disques du label.
Puis, lorsque je me suis lancé dans le journalisme, j’ai travaillé dans un premier temps à Londres, au sein d’un magazine qui s’appelait Music Week, où j’étais davantage du côté créatif, puis j’ai traversé l’Atlantique et j’ai travaillé aux États-Unis pour le Billboard. J’ai donc principalement travaillé en tant que journaliste spécialisé dans l’industrie musicale au cours de ma carrière. Puis, au début des années 2000, je suis arrivé chez Universal, qui s’occupait du catalogue Motown, ce qui m’a bien sûr aidé.
Mais oui, j’ai consacré toute ma vie à la musique, en quelque sorte. Mais cela a toujours été la partie business qui m’intéressait le plus, y compris dans le cas de la Motown. J’ai lu de nombreux livres sur le label au fil des ans, mais la plupart se focalisent sur les artistes et la musique, ce qui fait sens. Mais je me suis toujours intéressé aux gens qui se cachaient derrière la musique : les musiciens et les auteurs, mais aussi les hommes d’affaires des maisons de disques. Et encore plus dans le cas de la Motown, car c’était un mélange de personnalités des plus intéressants. Je les surnomme les backroom believers (« les croyants en coulisses », littéralement, ndlr). Vous savez, des gens comme Barney Ales, dont je parle dans le livre, et d’autres comme Esther Edwards, la sœur de Berry. C’est un autre aspect qui m’intéressait : Berry donnait des responsabilités aux femmes, bien plus que d’autres maisons de disques à l’époque. Et il comprenait également que pour percer dans le milieu, il devait embaucher des Blancs aussi bien que des Noirs. Donc cela m’a toujours intéressé de comprendre qui étaient ces personnes en coulisses, et de ce point de vue là, mon parcours en tant que journaliste m’a bien aidé.
Lorsque j’étais enfant et que j’écoutais de la musique, j’entendais toujours parler du chart Billboard, et je me demandais : « C’est quoi le Billboard ? » J’avais une tante qui vivait en Amérique et je lui ai demandé : “Est-ce que tu pourrais me trouver ce magazine et me l’envoyer ?” Et vous ne pouviez pas vraiment l’acheter en kiosques à l’époque, c’était un magazine d’affaires. Donc lorsque je l’ai eu entre les mains, cela m’a ouvert un univers complètement nouveau et c’était excitant. On ne trouvait pas uniquement des informations sur la marque de rouge à lèvres que portaient les Supremes ou sur les auteurs des chansons, mais aussi sur le côté business.
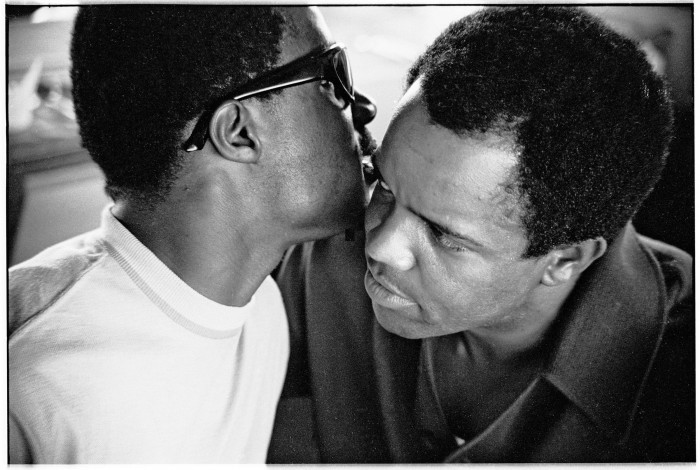
Culturellement Vôtre : A quel moment avez-vous décidé d’écrire un livre aussi complet sur l’histoire de la Motown ? Comment le projet a-t-il démarré ?
Adam White : J’ai beaucoup écrit sur la Motown au fil des ans, y compris avant de travailler pour Billboard, mais je pense que je connais Barney depuis plus de 40 ans maintenant et, il y a environ 10 ans de cela, nous déjeunions ensemble à Los Angeles et il m’a dit : « Est-ce que cela t’intéresserait d’écrire un livre sur la Motown et moi ? » Et c’est comme ça que je me suis lancé sur le projet. Mais à l’époque, je lui ai répondu : « Tu sais Barney, c’est une question dangereuse, car j’ai un nouveau patron chez Universal, Lucian Grainge, et je vais être occupé pendant un bon moment. » Et, comme vous le savez, Universal fait partie de Vivendi, donc nous nous sommes mis d’accord pour le faire, tout en sachant que cela prendrait un moment, car je travaillais sur d’autres choses.
J’ai donc travaillé sur le livre par petits bouts pendant 10 ans, au final. Mais c’est vraiment un travail fait avec amour. Et parce-que Barney était vraiment un « homme de l’intérieur », j’ai pu lui poser toutes les questions que j’avais toujours rêvé de poser sur la Motown, que ce soit au sujet des gens qui travaillaient là-bas, la manière dont l’entreprise faisait tourner ses affaires ou encore à quoi ressemblait le travail au sein d’un label américain dans les années 60-70, d’un point de vue à la fois politique et culturel.
Culturellement Vôtre : Quelle part des informations du livre viennent directement de Barney Ales ? Et combien d’entretiens avez-vous réalisés pour le livre ?
Adam White : Je pense avoir été chanceux car en raison de mon amour pour la Motown, j’ai interviewé de nombreuses personnes au cours de ma carrière et enregistré tous ces entretiens. Lorsque je travaillais au Billboard, j’interviewais les artistes et les musiciens, comme Earl Van Dyke, qui était le claviériste principal du groupe Funk Brothers de la Motown. J’ai donc compilé toutes ces interviews. L’interview de l’avocat de Stevie Wonder, je l’ai réalisée à la fin des années 70, par exemple, il n’en a plus donné par la suite. J’ai donc de la chance d’avoir pu me construire mes propres archives, mais j’ai dû réaliser entre 50 et 75 nouvelles interviews pour ce livre. Je suis donc retourné voir certaines personnes que j’avais déjà interviewées, et j’en ai rencontré d’autres pour la première fois, des personnes qui travaillaient pour Berry et Barney.
Par exemple, il y a ce type, Miller London, qui fut le premier VRP noir engagé en 1969. J’avais déjà rencontré Miller auparavant et je savais qui il était, mais je n’avais jamais eu l’occasion de l’interviewer en bonne et due forme, c’était donc parfait. Il vit à Detroit, a réussi dans les affaires. Cela m’a donc vraiment éclairé, et j’ai également rencontré des personnes qui travaillaient pour Barney, des commerciaux notamment. Je savais que j’obtiendrais de super histoires en allant voir les personnes qui se trouvaient en coulisses. Berry Gordy bien évidemment, Smokey (Robinson, ndlr), et d’autres personnes qui travaillaient avec les artistes. Malheureusement, bien sûr, de nombreuses personnes qui étaient là à l’époque sont mortes depuis, donc je n’ai pas pu avoir tout le monde.

Culturellement Vôtre : Saviez-vous dès le départ que vous parleriez de manière aussi approfondie des distributeurs des labels, par exemple, et de tout l’aspect plus technique lié au fonctionnement d’une maison de disques ?
Adam White : Oui, car c’est généralement l’histoire qui n’est jamais racontée. Lorsque j’ai commencé à travailler sur le livre, il y avait environ une cinquantaine de livres sur la Motown, qui s’intéressaient surtout aux artistes et à la musique. Très peu comportaient autant d’images que ce que nous proposons dans Motown, où nous avons vraiment voulu que l’histoire soit également racontée par les photos. Lorsque nous avons découvert cette musique en Angleterre, nous voyions les photos dans les magazines, et le look des artistes avait un véritable impact. Or, aucun ouvrage sur le sujet ne proposait véritablement cela. Il y a peut-être eu un livre qui est paru il y a 5-6 ans de cela uniquement en France, co-écrit par Gilles Pétard (Motown : Soul & Glamour, paru en 2009 chez Le Serpent à plumes, ndlr), qui travaillait pour la branche française de Motown, et il s’agissait aussi d’un beau livre assez volumineux, très bon, mais uniquement disponible en français. Donc l’aspect visuel était important.
Mais ensuite, je ne voulais pas répéter les mêmes choses au sujet des Supremes, des Temptations, Marvin et Stevie. Alors, comment faire ? Eh bien, en s’intéressant à la partie business, et, je l’espère, cela vient apporter des éléments nouveaux et enrichir les connaissances à ce sujet, plutôt que simplement répéter ce qui a déjà été dit ailleurs.
Culturellement Vôtre : Oui, tout à fait, car il s’agit de quelque chose dont on parle finalement assez peu souvent en détail. Je pense qu’il y a un intérêt pour le sujet, notamment quand on regarde la série de HBO, Vinyl, où les personnages parlent beaucoup des contrats et de ce genre de choses. Creuser cet aspect enrichit vraiment le livre, car on ne voit jamais les gens qui se trouvent derrière les bureaux, finalement.
Adam White : Merci, c’est exactement ce que j’essaie de faire. L’exemple typique est Stevie Wonder : il n’était qu’un enfant quand il est entré à la Motown et lorsqu’il est devenu un homme, il a écarté le label. Lorsqu’il a atteint 21 ans (l’âge de la majorité aux États-Unis, ndlr) et qu’il a pu prendre en charge sa carrière, il s’est entouré de cet avocat, Johanan Vigoda, qui était un homme à l’allure assez étrange, comme je l’explique dans le livre : il mâchait des graines de potiron, dont il recrachait l’écorce, il perdait sans cesse ses clés de voiture alors qu’il vivait à Los Angeles…
Mais ce qui était intéressant chez Vigoda, qui fut un avocat très efficace pour Stevie, c’est qu’il était en quelque sorte le double inversé de Berry Gordy : Berry se fichait de vos origines ou de votre couleur de peau, du moment que vous faisiez votre travail. Et lorsque Stevie est devenu adulte et a engagé cet avocat, il se fichait bien de son apparence et de ses excentricités, il cherchait avant tout quelqu’un qui puisse remplir correctement sa fonction. Et il m’a semblé que cela reflétait de manière intéressante ce que Stevie avait appris en grandissant au sein de la Motown. Donc oui, lorsque vous écrivez un livre tel que celui-ci, vous essayez de trouver ce type de personnalités intéressantes…
Barney Ales en faisait lui aussi partie, d’ailleurs : d’origine italienne, avec de l’expérience dans les affaires, ce qui s’est avéré très utile pour Motown car il connaissait les distributeurs, les radios, les DJ, et il a été en mesure d’apporter son savoir-faire chez Motown. Et aussi, Berry et lui avaient l’habitude de plaisanter et de jouer sur le fait qu’un Blanc et un Noir dirigeaient l’entreprise. Et parfois, Berry donnait volontairement l’impression aux gens que Barney était le propriétaire et ils plaisantaient avec ça. Barney racontait par exemple que Motown lui appartenait mais qu’il l’avait perdue en jouant aux cartes contre Berry, ce genre de choses… Ils avaient une véritable complicité dans leur manière de travailler ensemble.
Il fallait comprendre qu’à l’époque, l’industrie musicale était contrôlée par les Blancs. Il fallait donc quelqu’un qui connaisse le milieu et soit capable de faire face à ces personnes. C’est ce qui explique en partie leur succès, je pense, sans même parler du climat politique de l’époque. Berry était malin : il voulait simplement s’entourer des meilleurs. Il ne militait pas pour les droits civiques, ne cherchait pas à pousser au changement, car le changement est venu de la musique.

Culturellement Vôtre : Vous parlez beaucoup des artistes de la Motown tout au long des 400 pages du livre. Cependant, vous parlez moins de certains groupes et chanteurs bien moins connus que Stevie Wonder, Marvin Gaye ou les Supremes. Cela a-t-il été compliqué pour vous de faire un choix et de privilégier certains artistes au détriment d’autres ?
Adam White : Oui, en effet, car je connaissais tous ces artistes moins célèbres, j’adorais leur musique et j’avais leurs disques. Mais en vérité, les gens que j’ai interviewés se souviennent bien plus facilement des grandes stars. Barney peut parler facilement de Marvin, Stevie ou Diana. Les groupes moins connus, comme les Velvelettes, n’ont jamais fait de grands tubes, donc ils n’ont pas laissé la même trace dans la mémoire des gens de l’industrie, ce qui est évidemment dommage. Mais en réalité, ce sont les stars qui permettent de raconter l’histoire.
Certaines personnes ont néanmoins tenu à apporter leur témoignage, comme Chris Clark, qui n’a jamais vraiment eu de grands succès, même si elle co-écrit le scénario de Lady Sings the Blues un peu plus tard, mais en tout cas elle n’avait pas eu de tubes en tant qu’interprète. Et elle m’a donné un aperçu de ce que cela faisait d’être au sein du label dans cette situation. Mais, dans le cas de Stevie, il est clair que les anecdotes le concernant sont intéressantes à la lumière de son succès, comme celles qui concernent son avocat, Vigoda, dont on connait avant tout le nom car Stevie est une immense star. Je ne suis pas sûr qu’autant de monde se souvienne des autres artistes qui n’ont pas rencontré de véritable succès avec leurs albums… Ce qui n’est pas vraiment important car leur musique reste géniale.
Culturellement Vôtre : Votre livre cite de très nombreux morceaux et albums, certains très célèbres, qui ont marqué l’histoire de la Motown, d’autres qui ont été plus ou moins oubliés. Combien de temps avez-vous passé à sélectionner les différentes pochettes de disques, par exemple ?
Adam White : C’était assez amusant à faire puisque la plupart font partie de ma collection, donc je les connaissais depuis très longtemps, et certaines me sont très chères, comme celles des Four Tops, que j’adore. Lorsqu’ils tournaient en Angleterre, je les suivais de ville en ville… Mais ce que je trouvais intéressant avec ces pochettes de disques, c’est de voir la manière dont elles ont évolué, du point de vue de la mode et de leur style en général. Les toutes premières pochettes de la Motown étaient plutôt cheesy, par exemple. Certaines d’entre elles n’étaient pas vraiment sophistiquées, contrairement à ce que le label a fait quelques années plus tard.

Observer l’évolution des différents looks, des différents styles, était donc intéressant. Mais ma préférée est ce cliché alternatif de Marvin Gaye issu de la séance photo durant laquelle a été prise la pochette de son album What’s Going On. Sur l’image retenue pour la pochette, on le voit d’humeur assez sombre et dure. Mais au cours de la même séance, on peut également le voir heureux dans son jardin, avec le vélo de son fils en arrière-plan. Lorsqu’il était abattu par la mort de Tammi Terrell, il avait arrêté d’enregistrer pendant un moment et de jouer, et Motown voulait sortir une compilation de ses tubes. Et en guise de pochette, ils ont mis un dessin de lui en Superman, ce qui l’a beaucoup contrarié, car à ce moment-là, il prenait les choses très au sérieux à cause de la mort de Tammi, il ne savait pas vraiment où il allait en tant qu’artiste…
Donc lorsque le label a utilisé ce dessin, cela l’a tellement énervé qu’il a appelé Berry, qui a appelé Barney, et ils ont dû s’en occuper. Et j’ai trouvé cela assez révélateur du pouvoir des artistes, de l’influence qu’ils acquièrent, qu’ils puissent dire : « Non, ce n’est pas moi, ça ! » Et, il y a peut-être 5 ou 6 mois de ça, j’ai appris par Janis, sa seconde épouse, qu’il adorait cette pochette. Donc, peut-être une dizaine ou quinzaine d’années plus tard, il a fini par voir les choses différemment.
Mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de la manière dont une œuvre d’art peut immortaliser un instant dans la vie d’un artiste, qu’ils en soient fiers ou pas. Mais c’est également une partie de l’histoire que je raconte dans le livre. On pourrait aussi dire la même chose des pochettes d’albums de Stevie : elles étaient très simples et épurées au départ, et elles ont fini par devenir bien plus sophistiquées vers la fin, avec des volets, ou un portrait de Martin Luther King… Donc étudier cette évolution était assez amusant de ce point de vue-là. D’ailleurs, au tout début, la Motown n’avait pas de directeur artistique à proprement parler. Ils n’ont engagé des professionnels que plus tard.

Culturellement Vôtre : Vous parlez également beaucoup du contexte social des années 60, avec les émeutes et la ségrégation. Un détail m’a marquée parmi les anecdotes que vous relatez : lors d’une tournée, des personnes travaillant avec le label ont voulu faire une blague aux artistes et se sont mis devant leur bus, au milieu de la route, en tenant des fusils, ce qui leur a fichu une trouille bleue car cela leur rappelait des incidents qu’ils avaient connus dans le Sud des États-Unis. Pourriez-vous nous en dire plus ?
Adam White : Oui, cette histoire est intéressante car elle s’est produite en Angleterre lorsque la tournée de la Motown est passée par là. Ils avaient d’ailleurs fait l’Olympia de Paris à la fin de cette tournée. Mais c’est intéressant car cela est assez révélateur de l’innocence des Anglais qui les entouraient. Ils ne réalisaient pas vraiment, à l’époque, ce que pouvait signifier pour des artistes américains le fait de voir des hommes armés se tenir face à un bus.
Ce qui m’intéressait surtout, c’était la différence de traitement des artistes Motown en dehors de leur pays. Mary Wilson en parlait plus particulièrement : la première fois que les Supremes sont venues en Angleterre, elles ont été traitées comme des princesses, et lorsqu’elles sont rentrées en Amérique, on les a traitées comme des négresses. C’est la musique qui comptait avant tout pour les gens outre-Atlantique, et notamment en France où il y a toujours eu une vraie tradition jazz et blues, un respect pour les musiciens afro-américains. Et les artistes étaient tout à fait conscients de la signification de ce qu’ils disaient aux gens. J’ai vraiment pris conscience du fait que les artistes de la Motown étaient davantage respectés et moins discriminés, pour ainsi dire, en Europe, et c’est aussi pour cette raison qu’ils prenaient autant de plaisir à y venir. A tel point que certains ont emménagé en Angleterre, comme Jimmy Ruffin, car l’atmosphère était toute autre.
Berry n’était pas quelqu’un de politisé, il était avant tout un homme d’affaires et ne se mêlait pas vraiment de tout ça. Il était conscient de ce qu’il se passait bien sûr, et des discriminations qui pesaient sur la Motown. Mais son objectif était de réussir dans les affaires, donc il se fichait de votre couleur de peau tant que vous étiez compétent dans votre travail, ce qui explique comment quelqu’un comme Barney a pu devenir aussi important au sein du label. Berry était concentré sur les affaires et le succès, plutôt que l’aspect politique des choses. Bien sûr, il était un homme d’affaires accompli à une période mouvementée, donc je ne dis pas qu’il n’avait pas conscience des choses ou n’avait pas son opinion à ce sujet, simplement, il ne l’exprimait pas ouvertement. Les opinions politiques de la Motown passaient par la musique.
Plus tard, le label s’est un peu plus politisé, notamment avec les Temptations et les chansons écrites par Norman Whitfield en particulier, desquelles émanaient un fort sentiment de fierté noire. Mais cela n’était pas le cas au départ, et cela reflétait aussi l’homme qu’était Berry, au sens où il voulait avant tout réussir. Et le fait qu’il n’était pas un militant expansif rendait la musique plus populaire, plus facilement acceptable aux États-Unis. Il n’avait pas de « programme » en tête, il voulait faire de la musique, du divertissement.
Les Supremes, en particulier, ont tout changé de ce point de vue là lorsqu’elles sont devenues célèbres, notamment lorsqu’elles sont passé dans le Ed Sullivan Show, qui réunissait 30 à 40 millions de téléspectateurs le dimanche soir, à l’époque. D’un coup, les gens ont vu les Supremes, ces superbes femmes à la voix sublime et c’est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer : beaucoup d’artistes de la Motown ont été demandés après cette émission. Et je pense que cela a affecté le climat politique et social, mais c’était avant tout une question de musique au départ, pas de politique.

Culturellement Vôtre : Les artistes de la Motown ont connu un immense succès dans les charts, bien avant que le hip-hop n’apparaissent. Vous mentionnez Dr. Dre, Jay-Z, Beyoncé ou Rihanna, qui occupent une place prépondérante dans l’industrie musicale actuelle, dans la conclusion du livre. Quel est l’héritage de la Motown, selon vous ? Le trouve-t-on dans la musique urbaine ou également ailleurs ?
Adam White : Hmm… Il y a eu des changements très pragmatiques au sein de l’industrie musicale, suite au succès de la Motown. Avant la Motown, il n’y avait jamais eu de maison de disques tenue par un Noir avec un tel succès. Ses concurrents ont donc fini par réaliser qu’il y avait un marché pour la musique noire, peu importe la couleur de peau du public. Et à la fin des années 60, d’autres labels ont commencé à investir dans la musique noire à une plus grande échelle que ce qu’ils avaient pu faire auparavant. CBS, Warner, Capitol, ils se sont tous lancés sur cette voie…
Et évidemment, lorsque la Motown a déménagé en Californie, cela a eu un impact, car d’autres compagnies étaient prêtes à offrir beaucoup d’argent aux artistes afin de les attirer. Mais la Motown a montré le potentiel de la musique noire, cela a reconfiguré les lois de l’industrie du disque, car les personnes qui la dirigent ont compris que cette musique pouvait également plaire à un public blanc, au même titre qu’à un public noir. Le hip-hop est l’extension logique de cela et il est évident qu’il n’y aura pas de retour en arrière puisque certains des artistes les plus connus sont des musiciens noirs. Et la Motown a joué un rôle essentiel dans la démocratisation de la musique, en rendant les questions raciales hors de propos. Evidemment, c’est aussi une question d’argent en ce qui concerne le hip-hop, mais c’est ainsi que tourne le monde.
Donc, du point de vue des affaires, l’héritage de la Motown se trouve là. Et au niveau musical, l’héritage de la Motown est représenté par les œuvres de Stevie, Marvin ou Smokey : ils sont admirés et éminemment influents, encore aujourd’hui. Vous écoutez de la musique aujourd’hui et vous pouvez reconnaître Marvin ou Stevie dans la voix de tel artiste ou leur manière de chanter. Il y a donc deux héritages, si vous préférez : l’héritage du point de vue de la politique et du business, et l’héritage créatif. Ce qui est également intéressant, c’est la volonté des artistes, dans les années 70, d’être eux-mêmes, d’être indépendants. Ils ont tout appris pendant 10 ans à la Motown, mais ensuite, ils ont voulu s’affirmer. Et le pouvoir de l’artiste est toujours important aujourd’hui : les jeunes musiciens veulent prendre en main leur carrière d’un point de vue créatif afin de se trouver, plutôt que d’être défini et « révélé » par quelqu’un d’autre. C’est un long combat !
Culturellement Vôtre : Enfin, si vous deviez choisir seulement une chanson et un album de la Motown, quels seraient-ils ?
Adam White : Je redoutais cette question ! (rires) Cela dépend du jour de la semaine, à vrai dire. (rires) C’est vraiment dur, car cela a vraiment tendance à changer d’un jour à l’autre. Mmm… Personnellement, les Four Tops étaient mes artistes préférés. Ils ne sont plus vraiment à la mode aujourd’hui, car leur style et leur look étaient assez rétro, mais leur musique, la puissance de la voix de Levi Stubbs sont toujours impressionnants ! Donc, j’hésite à choisir le tube des Four Tops « Ask the Lonely »… Lorsque je l’ai entendu la première fois, je n’arrivais pas à croire qu’une voix puisse être expressive à ce point. Donc je choisirais peut-être ce titre.
Et un album ? Mmm… Ca serait sans doute What’s Going On, mais la première fois que je l’ai entendu, j’ai vraiment eu du mal. Un peu comme quand Berry l’a entendu et a dit quelque chose comme : « C’est quoi, ça ? » Je peux dire que pour quelqu’un qui a grandi avec la Motown, What’s Going On était un album très difficile d’accès de prime abord. Mais en le réécoutant aujourd’hui, vous comprenez à quel point ce disque était extraordinaire, à quel point il reste intemporel. Donc je dirais sans doute What’s Going On, mais tout de suite derrière, très près, il y aurait The Temptin’ Temptations car il s’agissait du premier album de la Motown que j’ai écouté qui donnait l’impression d’avoir été conçu véritablement comme un album et non une simple compilation de tubes. Tous les titres étaient géniaux, tous sans exception. Comment faisaient-ils ? The Temptin’ Temptations possédait cette profondeur en tant qu’album, donc je le mettrais sans hésitation en seconde position.
Nous remercions chaleureusement Adam White pour sa disponibilité et son amabilité. Le livre Motown est disponible depuis le 12 octobre aux éditions Textuel. Découvrez notre critique.
Propos recueillis et traduits de l’anglais par Cécile Desbrun.





