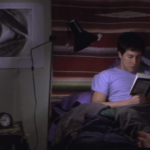Pleasantville (Gary Ross, 1998) est un film sorti à la même période que The Truman Show (Peter Weir, 1998), Dark City (Alex Proyas, 1998) ou Passé virtuel (Josef Rusnak, 1999) qui mettent en scène des villes du passé (les années trente à cinquante) qui ne sont que les décors d’un monde virtuel qui emprisonne les héros. Des films sensiblement inspirés des œuvres de l’écrivain Philip K. Dick. Mais le postulat de départ de Pleasantville s’inscrit plutôt dans la continuité de films tels que Gremlins (Joe Dante, 1984) et Retour vers le futur (Robert Zemeckis, 1985) mettant en scène des adolescents confrontés à la métamorphose d’une petite ville résidentielle par l’action d’un élément relevant du genre fantastique (les gremlins) ou de la science-fiction (la voiture à voyager dans le temps), mêlant chronique de l’adolescence, évocation satirique des petites villes résidentielles et effets spéciaux.
Isolé du reste de la communauté scolaire et avec des perspectives peu exaltantes, David (Tobey Maguire) n’a qu’une envie : fuir la réalité en se plongeant dans le monde confortable et rassurant d’une sitcom en noir et blanc des années cinquante, Pleasantville, où il fait toujours beau, où les policiers et les pompiers servent uniquement à aider les chats à descendre des arbres, où rien de choquant et de dramatique ne peut arriver, où les valeurs familiales triomphent toujours. David dit les répliques avant qu’elles soient énoncées, il connaît le contenu de tous les épisodes : rien d’imprévisible ne peut troubler la fiction qu’il voudrait comme existence. C’est pourtant ce qui va se produire grâce à une télécommande magique qui va le transporter avec sa sœur Jennifer (Reese Witherspoon), dans le monde fictif de Pleasantville.

Une utopie de l’écran, sans ailleurs ni imprévisible
Il s’agit à la fois d’une immersion au sein d’une image et d’un voyage dans le temps. Dès qu’ils utilisent la nouvelle télécommande, David et Jennifer se synchronisent avec les personnages de la série dont ils prendront la place (Bud et sa sœur Mary Sue), se battant pour une télécommande tandis que leurs doubles fictifs et idéalisés des années cinquante se chamaillent pour un transistor. Dès lors ils vont pénétrer dans le monde de la fiction et vont devoir adopter le langage, l’attitude, les codes et les interdits de la série Pleasantville : toute leur existence est désormais soumise aux exigences puritaines du feuilleton, à ses valeurs familiales et à ses conventions génériques.

Comme toutes les utopies, la ville de Pleasantville est close, fermée sur elle-même. C’est l’écran qui la sépare du monde extérieur, qui n’existe pas pour les personnages qui l’habitent. Comme il n’y a pas de d’ailleurs géographique, aucune autre culture n’existe dans Pleasantville sinon celle de l’American way of life exaltée dans les années cinquante dont la série Pleasantville est la représentation carton-pâte. On ne peut apprendre que la géographie de la ville, l’histoire de son patrimoine, et tout ce qui permet aux personnages de suivre le scénario qui les détermine. Dans un diner, on ne peut que commander un cheeseburger et un Cherry Coke, non une salade et une bouteille d’Evian comme le demande Jennifer/Mary Sue, car Evian n’est pas Américain.
La monde fictif de la série se compose de deux rues principales dignes de Disneyland : Main Street et Elm Street, en forme de T comme un décor de studio (backlot). Les personnages du monde de Pleasantville ne savent pas ce qu’il y a au-delà Pleasantville, et pour cause, la série ne montre jamais ce « dehors » qui n’existe pas. À Jennifer/Mary Sue qui demande ce qu’il y a au bout de Main Street, la professeure répond : « Mary Sue, tu devrais connaître la réponse. Au bout de Main Street, on retombe sur son début. » Violant toutes les lois physiques et mathématiques, brisant toute notion d’espace réel par une boucle impossible, comme dans une gravure de M.C. Escher, la rue se rejoint elle-même en ligne droite sans avoir à faire le tour de la Terre, mais juste celui du pâté de maison.
L’enfermement apparaît aux habitant de Pleasantville aussi naturel que les conventions qui dictent leur vie, leur liberté de mouvement étant aussi réduite que leur liberté de pensée (les pages des livres de la bibliothèque sont blanches). Pas de sexe, pas de violence, pas d’altérité, pas de liberté de savoir et de conscience : la censure télévisuelle est une réelle censure politique dans la mesure où l’image est devenue un monde habitable. C’est donc un monde totalitaire que David et Jennifer découvrent derrière la façade rassurante du conformisme puritain de l’American Way of Life. Ignorant qu’ils sont prisonniers de ce système, les habitant de Pleasantville s’éveilleront progressivement grâce aux actions des deux jeunes étrangers. Lorsque les couleurs commenceront à envahir le monde, leur sphère culturelle s’élargira, ou du moins le rock’n roll surgira. Les images européennes s’introduiront dans ce monde par le biais d’un livre d’histoire de l’art qui servira d’inspiration au peintre incarné par Jeff Daniels.

Le surgissement de l’altérité
Comme toutes les créations humaines, la série Pleasantville est finie, elle est limitée par les possibilités imaginées par ses créateurs. Mais la fiction va s’ouvrir à l’impensable, à l’incréé, sinon à l’infini, grâce à l’irruption de David et Jennifer. La première couleur survient dans ce monde noir et blanc après que le petit ami de Jennifer/Mary Sue ait découvert le plaisir de faire l’amour : une rose rouge apparaît dans un buisson. Les personnages de la série vont changer : ils se mettront à voir que les filles ont des poitrines attirantes, et que sortir avec l’une d’entre elles ne se réduit pas à lui offrir son insigne. Tout devient « autre » à leurs yeux, comme autant de territoires inconnus à découvrir : arts, littérature, politique, sexe…

La nature véritable, non mise en scène, surgit lorsque la déterminisme des personnages est rompu : un arbre s’enflamme lorsque la « mère » de David/Bud (Joan Allen) a un orgasme pour la première fois. L’orage survient pour la première fois, le monde se détraque, s’ouvre au réel et à ses accidents, brisant la programmation. Les gens pensent, les avis divergent, les désaccords sont nés, la vie tranquillement prévisible de Pleasantville s’est ouverte à l’accident, marqué par la pluie dans ce monde où il faisait perpétuellement beau temps.

Ce qui est naturel apparaît alors comme contre-naturel aux habitants de Pleasantville les plus conservateurs, puisqu’il menace la cohérence de leur fiction confortablement prévisible. Ainsi, lorsqu’un des personnages de la série sort du chemin tracé pour lui par les scénaristes, il commet l’impensable aux yeux des autres personnages : il échoue à marquer un panier ! Son ballon n’obéit plus aux lois de la fiction, il devient un monstre contre-naturel : « N’y touchez pas ! » dit avec autorité l’entraîneur aux autres basketteurs. Trop tard, la métamorphose a commencée, le monde de Pleasantville va s’ouvrir à la « monstruosité », c’est-à-dire à l’autre, dans la mesure où le « monstre » est quelque chose de désigné, le fruit d’une « monstration ». Le personnage de David (Tobey Maguire) est à l’image de ces masses séduites par la cohérence du récit proposé par le totalitarisme, que décrit Hannah Arendt dans Le système totalitaire : il s’oppose de plus en plus à sa sœur qui trouble l’ordre inhabitable de la fiction qu’il aime tant, avant de finalement rejoindre les rebelles « colorés » face à la dérive fasciste du mouvement conservateur. Pour préserver l’ordre apparent, David/Bud propose à sa mère de la maquiller en noir et blanc, afin de cacher qu’elle s’est ouverte à l’inconnu, qu’elle est devenue une autre : une personne singulière, libérée de sa fiction.

Puisque les personnages se colorisent au fur et à mesure de leurs découvertes (sexuelles, surtout), deux catégories visibles de population se crée : ceux qui demeurent des personnages et ceux qui sont devenus des individus. Les premiers, ancrés dans le passé et la représentation sont en noir et blanc ; les seconds, prenant pied dans le présent et le réel, sont en couleurs. Une discrimination s’installe progressivement, les couleurs étant perçues par les plus conservateurs des habitants comme les symptômes d’un mal corrupteur à éradiquer, une gangrène menaçant de détruire leur monde. D’opposants subjectifs (de pensées différentes, quoique cela était impossible à Pleasantville), les opposants sont devenus objectifs (de nature différente), pour reprendre la distinction d’Hannah Arendt dans Le système totalitaire. Le monde extérieur qui n’était pas pensé, puisque n’existant pas, est devenu une menace environnante, dont les habitants en couleurs sont les représentant à l’intérieur de leur monde clos. Une discrimination s’installe entre les « vrais citoyens » (comme l’indique une affichette) et les autres.

Pour que Disneyland soit une expérience satisfaisant toujours l’attente de bonheur, le visiteur doit de même accepter de se soumettre à un dispositif de consommation fondé sur des déplacements programmés, invité à consommer des lieux dont il est l’habitant illusoire. De même, pour que l’univers de Pleasantville demeure tel qu’il est, David et Jennifer devraient se soumettre à un scénario écrit pour d’autres, être aussi prévisibles que les autres personnages et donc devenir des androïdes selon la définition de Philip K. Dick : « Devenir ce que, faute d’un terme plus convenable, j’ai appelé un androïde, veut dire, comme je l’ai indiqué, se laisser transformer en instrument, se laisser écraser, manipuler, devenir un instrument à son insu ou sans son consentement ― c’est du pareil au même » (Conférence « Androïde contre humain », 1972).
Jennifer/Mary Sue, comme tous les habitant de la série qui se sont ouverts à l’altérité et colorisés, ne peuvent revenir en arrière. Ils ne peuvent renoncer à leur liberté acquise, telle la mère fictive de Mary Sue et Bud qui a découvert l’amour avec le peintre (Jeff Daniels), et a décidé de mettre fin à son rôle d’épouse au service de son mari. Dans une séquence très drôle, ce dernier père rentre chez lui comme à son habitude, pose sa mallette et accroche son chapeau au porte-manteau et dit « Chérie, je suis rentré ! », mais son épouse ne vient pas l’accueillir. Elle n’est pas là. Il vérifie qu’il a bien fait ses gestes dans le bon ordre, comme si la venue de son épouse était dépendante de cette suite de mouvements. Il parcourt toutes les pièces de la maison en répétant « Chérie, je suis rentré ! », puis la phrase « Où est mon dîner? ». En vain. Il vient de rejoindre la liste des « victimes » de l’émancipation féminine. Un autre homme a eu sa chemise brûlée par un fer à repasser, ô tragédie ! « Il lui a demandé ce qu’elle faisait, dit le maire de Pleasantville. Elle a répondu : « Rien ». Elle pensait. Mes amis il ne s’agit pas du dîner de George, ni de la chemise de Roy. Il s’agit de valeurs, et de savoir si on veut garder ces valeurs qui ont fait cet endroit. Il est temps de prendre une décision. Sommes-nous seuls ou ensemble face à l’adversité? »

Résurgence du nazisme
Il faut, comme le dit le maire de Pleasantville, « séparer les choses plaisantes des choses déplaisantes. » Cette phrase pleine de ce sens commun à tous, amène en vérité une politique raciste. Des panneaux aux vitrines indiquent alors « No coloreds » (« Interdit aux colorés »), référence évidente aux mesures des nazis contre les juifs, et à la ségrégation raciale appliquée dans les États du Sud des États-Unis jusqu’aux années soixante. Avec pertinence, Pleasantvillemontre aussi quelles peuvent être les séductions d’un système totalitaire, qui apparaît comme la réalisation d’une utopie répondant aux besoins insatisfaits d’une population, pour mieux l’emprisonner dans le cauchemar de sa fiction, empêchant « qui que ce soit de troubler, par la moindre parcelle de réalité, la tranquillité macabre d’un monde entièrement imaginaire » comme l’écrit Hannah Arendt (Les Origines du totalitarisme, Le système totalitaire, Paris, Éditions du Seuil, 2005, p. 110). La préservation de cette fiction prime pour les conservateurs noir et blanc sur tout le reste : comme les nazis l’avaient fait auparavant, une législation censée ramenée l’ordre public impose une domination totalitaire, qui n’est autre que le dévoilement du vrai visage de l’utopie de Pleasantville. Voici les nouvelles lois :
- Troubles et actes de vandalisme doivent cesser immédiatement.
- Tous les citoyens de Pleasantville doivent être courtois et plaisants entre eux.
- Les endroits communément appelés Allée des Amoureux et la Bibliothèque municipale, doivent être fermés jusqu’à nouvel ordre.
- Les seules musiques autorisées seront les suivantes : Johnny Mathis, Perry Como, Jack Jones, les marches de John Philip Sousa, ou The Star-spangled Banner. On ne saurait tolérer de musique qui ne serait pas modérée ou plaisante.
- Il ne saurait y avoir de vente de parapluies ou autre, contre les intempéries.
- Sommiers et matelas ne sauraient faire plus de quatre-vingt-seize centimètres de large.
- Seules couleurs autorisées le noir, le blanc ou le gris, malgré l’habilité récemment découverte à d’autres alternatives.
- Les programmes scolaires enseigneront la pérennité de l’histoire, privilégiant la continuité au changement [alterations].

Ségrégation, autodafés, violence, lynchages : la peur et le sang surgissent dans Pleasantville, et le logo de la Chambre de Commerce se met à furieusement ressembler à la croix gammée nazie. C’est un totalitarisme absolu que prônent le maire et les conservateurs en imposant par des lois, et par la violence, une manière unique de percevoir la réalité, processus qui se nomme dans le roman 1984 de George Orwell (1950), l’« arrêtducrime », c’est-à-dire le fait de réagir immédiatement aux faits vus ou reçus en les passant à travers le filtre très étroit de ce qui est autorisé par le Parti. Winston Smith s’y entraîne : « Il soumettait à son esprit des propositions : « Le Parti dit que la terre est plate », « Le Parti dit que la glace est plus lourde que l’eau », et il s’entraînait à ne pas voir ou ne pas comprendre les arguments qui les contredisaient. » (George Orwell, 1984, Paris, Éditions Gallimard, traduit par Amélie Audiberti, 1984, pp. 391-392)
Ce déplacement de la représentation du monde, imposée par le pouvoir, vers la réalité que ses personnages doivent subir, a été considérablement développé par les œuvres de science-fiction de Philip K. Dick. Dans un essai que je prépare, je développerai ces idées, et particulièrement les rapports entre univers virtuels, utopies et totalitarismes, que Pleasantville a su saisir et mettre en scène d’une manière à la fois pertinente et jubilatoire. Un divertissement tel que ce film a eu l’audace de montrer l’infiltration du nazisme au cœur même de l’American Way of Life et de son imaginaire datant des années cinquante, qui continue d’imprégner le cinéma Américain, comme en témoignent les films de nostalgie qui abondent depuis American Graffiti (George Lucas, 1973). De ce fait, Pleasantville projette à l’écran des thèmes, des figures et des peurs qui étaient ceux de Philip K. Dick, qui déclare dans un entretien de 1974 que « la destruction des nazis allemands, la mort d’Hitler et de ses maréchaux ont dissocié le nazisme de l’Allemagne même et l’ont transformé en mouvement international qui existe partout sous des formes différentes, à l’Est comme à l’Ouest, qui s’infiltre parmi nous, de manière insidieuse, souterraine. » (Documentaire d’Elizabeth Antébi, Les évadés du futur, ORTF, 1973).
Faire renaître le rêve Américain
À la fin du film Pleasantville, tous les habitants sont conquis par leurs émotions au terme d’un procès dont l’illégitimité est dénoncée, et tous sont colorisés, même les plus réactionnaires. C’est l’appel à l’émotion qui sauve la communauté, et la libère de son système totalitaire. La fin dévoile l’ambiguïté du discours du film, qui est celle de nombre de films de nostalgie, après ses audaces de plus en plus radicales : malgré son ironie mordante, force est de constater que Pleasantville a pour objet du désir, tout comme les films de nostalgie, non seulement « la stabilité et la prospérité d’une pax americana mais également cette innocence originelle et naïve d’une contre-culture qui fut celle des débuts du rock n’roll et des bandes d’ados », comme l’écrit Fredric Jameson (Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, Paris, Éditions École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2007, p. 59).
Les couleurs ont complètement envahies le monde, et les téléviseurs diffusent enfin des images de l’extérieur. Mais ce ne sont que des stéréotypes : tour Eiffel, pyramides de Gizeh, surf. Le monde extérieur qui s’ouvre aux habitants de Pleasantville se réduit pas moins à des clichés que le mini-monde de l’attraction d’It’s a Small World qui invite le guest de Disneyland, tout comme l’homme des civilisations traditionnelles, à « se mirer dans les eaux du mythe de fondation, du schéma d’organisation du monde tel que le conçoit la société à laquelle il appartient », pour reprendre les mots de Jean Servier (Histoire de l’utopie, Paris, Éditions Gallimard, 1967, p. 15)
Des panneaux routiers indiquant des directions vers d’autres villes surgissent. Villes réelles ou de fictions? L’un des panneaux indique Springfield, ville des Simpsons, mais n’existe-il pas aussi un grand nombre de villes de ce nom aux États-Unis? La ville n’est plus en noir et blanc, mais un problème fondamental surgit : sans ses touches de rouge, bleu ou rose subversives, ne ressemble-t-elle pas d’autant plus au cliché que le film dénonce? N’est-elle pas réellement devenue la Main Street de Disneyland?

Film à l’écriture intelligente, brillamment réalisé par son auteur Gary Ross, Pleasantville, demeure en fin de compte conforme aux conventions du happy end et de la musique plaisamment triomphaliste qui n’aurait pas dépareillée dans un film Disney. Tous les personnages sont toujours habillés et coiffés de manière proprette, et certains stéréotypes demeurent : la sœur incarne la tentation charnelle, le frère quand à lui est plus intellectuel, l’un est le corps et l’autre l’esprit. Ils s’épanouiront l’un comme l’autre en découvrant son potentiel intellectuel pour la première (elle lit D.H. Lawrence) et corporel pour le second (c’est après s’être battu qu’il retrouve ses couleurs, comme s’il était ainsi vraiment un homme). De plus, c’est bien le frère qui prend le contrôle du groupe de rebelles, qui incarne l’autorité nécessaire pour le combat.
En vérité, Pleasantville n’a pas pour but de révolutionner la société dont il fait la satire, car les changement opérés dans le film (colorisation, libération des corps, ouverture culturelle) sont des outils permettant de rééquilibrer la cité traditionnelle qui lui sert de modèle, à l’image des « philosophes qui, en rebâtissant les murs de la cité antique, n’ont cherché qu’à mieux ancrer leur société dans le présent, à assurer son immortalité », comme l’écrit Jean Servier. (Ibid, p. 1) Force est de constater que la rébellion impulsée par les deux étrangers à l’univers fictif de Pleasantville a eu pour conséquence de réactualiser le rêve américain qu’exalte la série, pour que cette dernière redevienne un idéal à suivre, une proposition de cité à habiter.
Première version de l’article publiée sur le blog de l’auteur, le 25 octobre 2010, puis sur Ouvre les Yeux.
Cet article sur le film Pleasantville fait partie du dossier consacré aux rapports entre l’écrivain Philip K. Dick et le cinéma (à travers les adaptations officielles et les films qui s’inspirent de ses romans ou nouvelles).