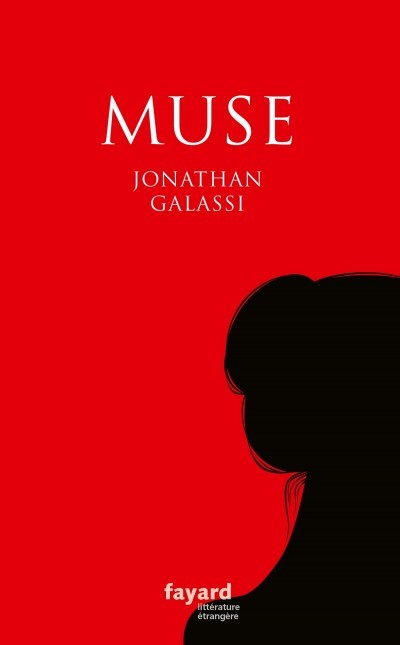 Éditeur chez Farrar, Strauss and Giroux à New-York, Jonathan Galassi, qui est également traducteur et poète à ses heures, fait ses débuts de romancier avec Muse, qui sort aujourd’hui aux éditions Fayard. Le livre mêle les deux amours de l’auteur, le monde de l’édition et la poésie, au sein d’une intrigue s’étendant sur plusieurs décennies, des années 50 à nos jours.
Éditeur chez Farrar, Strauss and Giroux à New-York, Jonathan Galassi, qui est également traducteur et poète à ses heures, fait ses débuts de romancier avec Muse, qui sort aujourd’hui aux éditions Fayard. Le livre mêle les deux amours de l’auteur, le monde de l’édition et la poésie, au sein d’une intrigue s’étendant sur plusieurs décennies, des années 50 à nos jours.
Jonathan Galassi imagine la poétesse ultime
Si Galassi a exclusivement traduit des poèmes italiens (ceux de Giacomo Leopardi et Eugenio Montale), c’est la littérature américaine qui l’intéresse ici, son histoire comme son évolution, et comment les éditeurs ont accompagnée cette dernière. Ode nostalgique au pouvoir des livres, au talent d’auteurs avant-gardistes et à une époque où les éditeurs et le public voyaient autre chose dans les livres qu’un simple produit, Muse est une oeuvre exigeante, qui se déploie lentement pour mieux nous prendre dans sa toile. L’histoire et les principaux personnages ont beau être entièrement fictifs, l’auteur s’amuse à semer le doute dès le départ en dédiant son roman à Ida Perkins, la légendaire poétesse américaine dont il met en scène le parcours, poussant même le « vice » jusqu’à ajouter une bibliographie complète de ses œuvres en fin d’ouvrage, comme cela se fait souvent pour les vrais auteurs. Si l’on n’est pas au fait de cet artifice en ouvrant le livre, un doute peut assaillir le lecteur au tout début : cette mystérieuse Ida Perkins serait-elle une véritable poétesse américaine tombée dans l’oubli et sur laquelle nous aurions curieusement fait l’impasse ? Jusqu’à ce que des détails assez gros (hommage de la part d’Obama à sa mort, recueils vendus par centaines de milliers dans les années 2000 ou encore une improbable collaboration musicale avec les chanteuses Carly Simon et Carole King à la fin des années 60) viennent confirmer qu’il s’agit bel et bien d’une figure fictive, inspirée d’un certain nombre d’autres personnalités célèbres de la littérature américaine afin de former LA poétesse absolue, ayant inspiré les plus grands, hommes comme femmes.
Ainsi, difficile de ne pas penser à Sylvia Plath (qui est d’ailleurs citée dans le roman) à la lecture des extraits de poèmes d’Ida Perkins. A dire vrai, la « muse » créée par Jonathan Galassi pourrait être vue comme une version de Plath sans la bipolarité, qui serait devenue une vieille dame pleine de sagesse plutôt que de mettre la tête dans le four à 30 ans. On retrouve sa dimension avant-gardiste, malicieuse et provocatrice, des références mythologiques qui ne sont pas sans rappeler celles présentes dans le recueil Ariel (1965). Mais Ida Perkins possède également quelques traits communs avec Anne Sexton, Elizabeth Bishop, Zelda Fitzgerald, ainsi qu’avec des poètes masculins tels que Robert Lowell. En parlant des Fitzgerald, on relèvera d’ailleurs que Perkins était le nom de l’éditeur de Francis Scott Fitzgerald, qui publia également les oeuvres d’Ernest Hemingway ou Thomas Wolfe aux éditions Scribner. Pur rêve d’éditeur (auteure géniale et grosse vendeuse), il n’est guère étonnant que la figure d’Ida Perkins rende hommage à celui qui fut considéré comme un éditeur de génie, à tel point que Genius n’est autre que le titre du biopic, sorti sur nos écrans le mois dernier, qui lui est consacré.
Le rêve d’une essence féminine sans entraves
L’utilisation du mot « rêve » n’est d’ailleurs pas exagérée lorsqu’il s’agit d’évoquer le personnage d’Ida Perkins : Jonathan Galassi ne se contente pas de faire d’elle la plus grande poétesse ayant jamais vécu, il fait également d’elle une mondaine et une diva atteignant un degré de célébrité tout simplement inenvisageable, même pour l’époque, du genre qui rivaliserait avec Janis Joplin, ferait la couverture du magazine Rolling Stone et vendrait un nombre d’exemplaires de ses recueils démentiel pour n’importe quel poète à l’aube de l’ère numérique. Condensé de ce que les grandes figures de la littérature, mais également de la musique pop et rock américaines peuvent avoir de plus incandescent, subversif et avant-gardiste, Ida Perkins apparaît comme une muse au sens premier du terme pour les personnages du roman, mais également à un niveau plus méta textuel : elle est l’essence même de l’auteure féminine transgressive, mais qui, malgré l’époque, n’aurait pas subi de backlash, ne serait pas devenue une martyre de l’amour, sacrifiée sur l’autel d’un système patriarcal et de la société de consommation, chose à laquelle on réduit un peu trop facilement Sylvia Plath de nos jours, par exemple, oubliant son humour grinçant au profit de la lecture d’un suicide annoncé. Ida n’est pas exempte de démons, mais elle ne les a pas laissés gagner, a assumé sa liberté sans ressentir le poids de la morale américaine à son encontre. Même la révélation lors du dernier tiers du livre ne provoque pas de scandale parmi ses lecteurs, c’est dire ! Sa lumière n’a jamais été occultée par la névrose, bien que sa dernière oeuvre révèle des ombres qu’on ne lui soupçonnait pas.
De fil en aiguille, le lecteur se prend d’affection pour cette figure omniprésente, bien qu’elle intervienne très peu de manière directe au sein de l’intrigue. Le jeune lecteur passionné, que l’on verra gravir une à une les marches du monde de l’édition, Paul Dukach, nous transmet sa fascination à son égard, si bien que l’on en oublie rapidement que certains des vers présentés dans le texte ne sont pas aussi brillants qu’ils sont supposés l’être, bien que les poèmes finaux, dans leur veine mimétique, si l’on peut dire, soient assez inspirés. A ce sujet, on regrette un peu de ne pas avoir la version originale des poèmes tels qu’ils ont été écrits par Jonathan Galassi, afin de prendre la pleine mesure du travail de l’auteur autour de la langue anglaise et ses sonorités.
Editeur, l’évolution d’un métier
Au-delà du portrait d’une figure fantasmée, vue à travers une multitude de regards et de prismes, Muse est également une déclaration d’amour au métier d’éditeur, abordé de manière passionnée mais non moins lucide, voire désenchantée à certains moments. Des rivalités et intrigues pour s’attirer les faveurs de tel ou tel auteur, dont il faut s’efforcer de ménager l’ego lors de la première lecture et tout au long des différentes étapes de correction, impression et distribution, aux liaisons plus ou moins connues, que ce soit entre auteurs ou bien entre ces derniers et leurs éditeurs, en passant par les subtilités et absurdités inhérentes au milieu (des éditeurs qui ne semblent rien connaître de la littérature ou de certains auteurs qu’ils envisagent de traduire ou éditer) et l’avènement du numérique et des distributeurs de mass market bradant les oeuvres pour écraser la concurrence, le roman de Jonathan Galassi propose un aperçu de toutes les différentes facettes de ce milieu particulier, entre tendresse et ironie.
On reconnaîtra ainsi derrière Medusa des références à peine voilées au géant Amazon, même si l’auteur va plus loin et imagine l’étape suivante dans l’évolution du marché : l’absorption des éditeurs historiques par le numérique et de grosses firmes. Cependant, bien que nostalgique face au recul du papier, dont on mesure de moins en moins la valeur en tant qu’objet, Galassi rappelle malgré tout que, sur papier ou sur tablette, l’important reste de lire, rejoignant ainsi le plaidoyer d’un Neil Gaiman (disponible dans son recueil d’essais The View from the Cheap Seats) sur ce sujet polémique et tabou s’il en est parmi les écrivains, qui pourrait se résumer à cette simple question : « Les ebooks signent-ils l’arrêt de mort du livre papier et faut-il les mépriser ? »
Une méditation poétique autour de la littérature
Enfin, en s’inspirant de figures connues, admirées ou bien côtoyées, l’écrivain dresse une galerie de portraits d’auteurs et éditeurs hauts en couleur et marquants, parfois un peu ridicules, mais souvent touchants. Cet hommage poétique à la littérature américaine, porté par une écriture dense et agréable à la fois, n’est pas sans rappeler, à certains égards, le sublime Possession d’A.S. Byatt (1990), qui proposait déjà une investigation autour de deux figures majeures de la poésie anglo-saxonne purement fictive. Alors que Mélusine hantait l’oeuvre de la poétesse Christabel LaMotte imaginée par Byatt, Mnemosyne hante le dernier recueil d’Ida Perkins. S’ils diffèrent par leur ton général, les deux romans ont en commun un même amour de la poésie et ses figures légendaires, tout en portant un regard lucide et satirique à la fois sur deux milieux distincts (le milieu universitaire pour Byatt, celui de l’édition pour Galassi) que leurs auteurs connaissent fort bien.
Muse apparaît donc comme une véritable réussite, qui devrait conquérir les amoureux de la littérature américaine des années 50 à 60. La connaissance de l’auteur, éditeur de métier, de ce milieu, associé à son amour sincère de la poésie se ressentent fortement dans ce roman à la passion communicative, méditation tour à tour nostalgique, tendre et grinçante sur ce qui fait l’essence de la grande littérature, celle qui transcende notre vision de l’amour, voire de l’existence, et s’inscrit en nous, nous permettant d’en saisir les différentes nuances au fil des lectures successives tout au long de notre vie. Un rapport si fort qu’il transcende même le support sur lequel l’oeuvre s’inscrit, bien que Jonathan Galassi soit, comme nous, un amoureux transi de l’objet livre, dont il regrette les belles éditions que l’on chérissait et qui tendent à se faire plus rares.
Muse de Jonathan Galassi, Fayard, sortie le 1er septembre 2016, 263 pages. 20,90€





